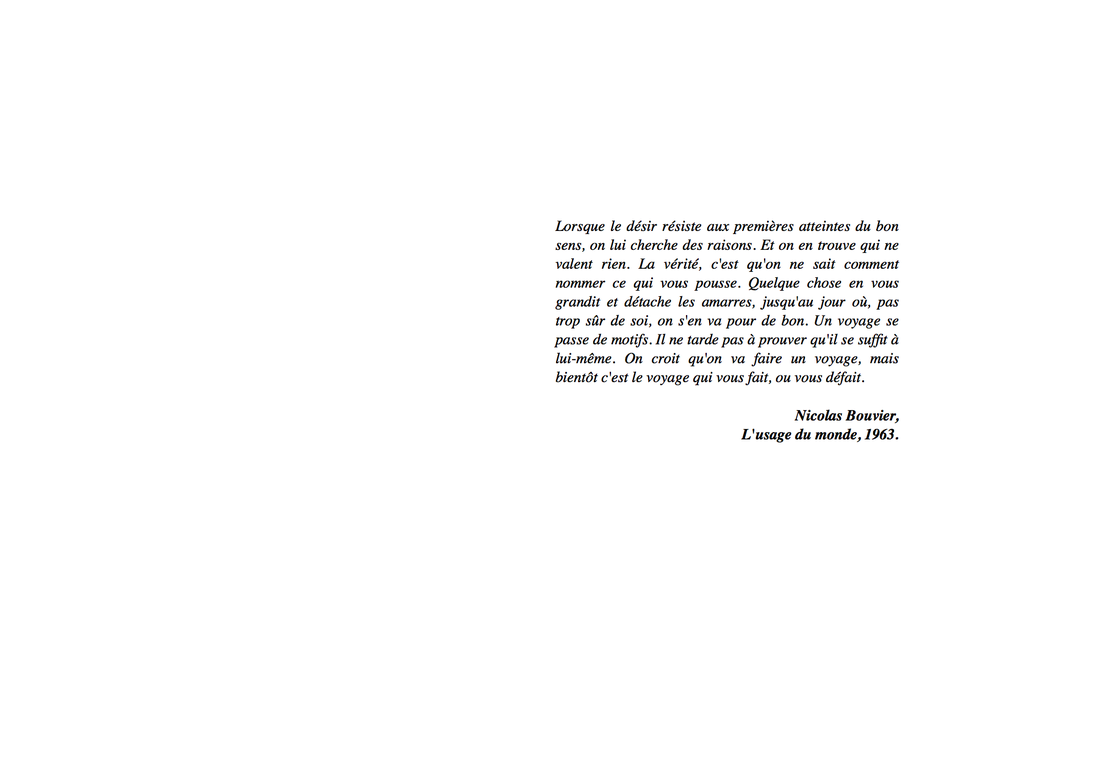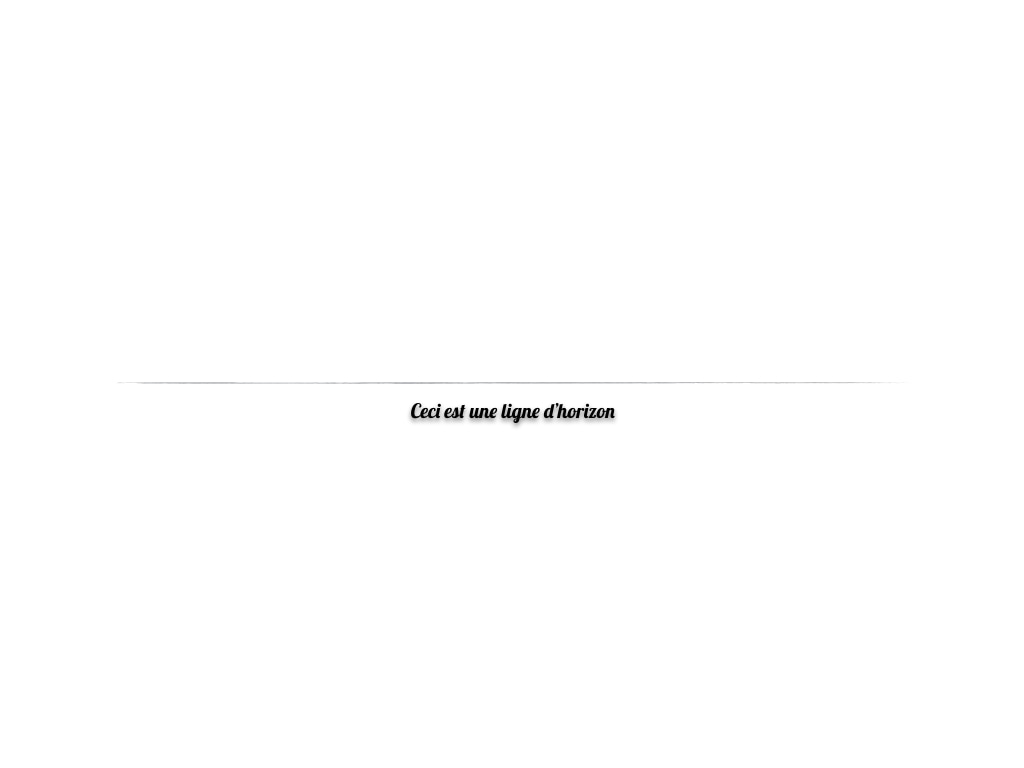Enfant, il m'arrivait souvent de regarder l'horizon et de me demander ce qu'il pouvait bien y avoir de l'autre côté de la mer. La Réunion, c'est la France, mais où se trouve la France, cette « Mère Patrie », celle qui se cache en dehors de La Réunion — cette île trop étroite pour contenir une si grande nation ? Personne ne savait me dire où la trouver. J’avais beau scruter l’océan comme un pirate lorgnant sur un trésor, je ne voyais rien à l’horizon. Rien ne transparaissait, ici, de cet idéal qui m’échappait.

Et puis, un beau jour, mes parents nous ont envoyé en vacances, ma soeur et moi, pour nous dégourdir l’esprit. Lorsque nous sommes montés à bord du Boeing 747, j’avais sept ans et elle, un an de plus. Les amis de nos parents sont venus nous chercher à l’aéroport de Paris. C'est là, que j’ai commencé à comprendre, enfin, à quoi ressemblait ce pays qui était aussi le mien, mais que je ne connaissais pas. J'appris ainsi qu'il y avait un monde de l'autre côté de l’horizon, beaucoup plus étendu et plus insolite que ne pouvait l’imaginer mon cerveau d’enfant.
Si la vie est long voyage de dix mille lieues qui commence par un petit pas, encore faut-il savoir où aller et pourquoi ? Mais, ça, Lao Tseu ne le dit pas ! Cependant, je crois que tout voyage commence d'abord à l’intérieur de soi, parce qu’avant tout, il faut trouver l’énergie et la confiance nécessaires pour vaincre sa peur. Lorsque l’on décide d’aller voir par soi-même, il faut savoir prendre son temps pour comprendre le monde et lui donner du sens. On ne devient véritablement humain, que lorsqu’on découvre les valeurs que l’on souhaite partager et que l’on assume nos responsabilités. C’est-à-dire, lorsque l’on devient capable de fixer soi-même un cap et de s'y tenir.
Ce qui rend le départ nécessaire, c'est la volonté réelle que l'on a d'aller de l'avant, pour voir autre chose, vivre autrement, et s'ouvrir l'esprit pour y faire entrer le monde.
J’ai décidé de rompre mes attaches, d’aller faire le tour de cette étrange planète où j’habite, mais dont je ne sais peu de choses en réalité. Trop longtemps, je suis resté enlacé à mon île natale, comme un ermite à son rocher. Mes voyages m’ont décillé les yeux, mais la Terre est trop vaste pour qu’on l’embrasse d’un seul regard. Il faut cheminer, suivre sa route, se perdre, se retrouver, se perdre inlassablement, s’ouvrir sans cesse, se confronter à l’inconnu, chaque jour, pour mesurer notre petitesse et découvrir, malgré tout, qu’ici ou là bas, tous les humains sont frères de sang.
Je prépare mon évasion depuis plusieurs mois, ou plutôt depuis plusieurs années, avec la sérénité de ceux qui savent que la précipitation ne sert à rien et avec l'énergie de ceux qui ont appris que sans effort, rien ne se construit. Puisque je pars, pourquoi se contenter de peu ? Je ne veux pas faire l’un de ces voyages pendulaires qui nous ramène au point de départ, si peu de temps après être parti. Je veux m’envoler pour de bon, m’en aller loin, non pour fuir, mais pour découvrir l’étendue du monde s’affirmant devant chacun de mes pas. La Terre s’étale devant moi. Je veux m’ouvrir à elle, complètement.
Pour que les choses soient claires dans mon esprit, je me suis fixé quelques règles d'une telle simplicité qu'il me semble presque incongru de les énoncer.
Règle 1 : L'argent ne doit pas conditionner la faisabilité du voyage. Avec ou sans, je partirai quand même. Bien sûr, un minimum est nécessaire, et je compte toujours garder en réserve l'équivalent d'un billet de retour.
Règle 2 : Le temps ne doit pas conditionner la réalisation du voyage. J'ai tout mon temps, puisqu'il m'appartient. Donc, je peux l'utiliser comme je le souhaite. Je ne veux pas faire un tour du monde en quatre-vingt jours, ni en quarante-huit heures. Je sais que je ne pourrai pas tout voir, et d'ailleurs, cela n'aurait aucun sens. Mais, je veux approcher l’âme de ceux que je rencontrerai, en ayant le temps de vivre à leur rythme.
Et enfin, règle 3 : Aucune obligation de résultat ne doit peser sur le voyage. Je reste libre de changer d'itinéraire à tout moment. Et même, si j'en éprouve le besoin, de mettre un terme à l'aventure. Je n'ai rien à prouver à personne. J'ai décidé de partir pour moi, sans financement. "Ma vie est mon message", disait Gandhi. En ce qui me concerne, cette façon de voyager, c'est ma vie, ma façon d'être au monde.
Ce qui rend le départ nécessaire, c'est la volonté réelle que l'on a d'aller de l'avant, pour voir autre chose, vivre autrement, et s'ouvrir l'esprit pour y faire entrer le monde.
J’ai décidé de rompre mes attaches, d’aller faire le tour de cette étrange planète où j’habite, mais dont je ne sais peu de choses en réalité. Trop longtemps, je suis resté enlacé à mon île natale, comme un ermite à son rocher. Mes voyages m’ont décillé les yeux, mais la Terre est trop vaste pour qu’on l’embrasse d’un seul regard. Il faut cheminer, suivre sa route, se perdre, se retrouver, se perdre inlassablement, s’ouvrir sans cesse, se confronter à l’inconnu, chaque jour, pour mesurer notre petitesse et découvrir, malgré tout, qu’ici ou là bas, tous les humains sont frères de sang.
Je prépare mon évasion depuis plusieurs mois, ou plutôt depuis plusieurs années, avec la sérénité de ceux qui savent que la précipitation ne sert à rien et avec l'énergie de ceux qui ont appris que sans effort, rien ne se construit. Puisque je pars, pourquoi se contenter de peu ? Je ne veux pas faire l’un de ces voyages pendulaires qui nous ramène au point de départ, si peu de temps après être parti. Je veux m’envoler pour de bon, m’en aller loin, non pour fuir, mais pour découvrir l’étendue du monde s’affirmant devant chacun de mes pas. La Terre s’étale devant moi. Je veux m’ouvrir à elle, complètement.
Pour que les choses soient claires dans mon esprit, je me suis fixé quelques règles d'une telle simplicité qu'il me semble presque incongru de les énoncer.
Règle 1 : L'argent ne doit pas conditionner la faisabilité du voyage. Avec ou sans, je partirai quand même. Bien sûr, un minimum est nécessaire, et je compte toujours garder en réserve l'équivalent d'un billet de retour.
Règle 2 : Le temps ne doit pas conditionner la réalisation du voyage. J'ai tout mon temps, puisqu'il m'appartient. Donc, je peux l'utiliser comme je le souhaite. Je ne veux pas faire un tour du monde en quatre-vingt jours, ni en quarante-huit heures. Je sais que je ne pourrai pas tout voir, et d'ailleurs, cela n'aurait aucun sens. Mais, je veux approcher l’âme de ceux que je rencontrerai, en ayant le temps de vivre à leur rythme.
Et enfin, règle 3 : Aucune obligation de résultat ne doit peser sur le voyage. Je reste libre de changer d'itinéraire à tout moment. Et même, si j'en éprouve le besoin, de mettre un terme à l'aventure. Je n'ai rien à prouver à personne. J'ai décidé de partir pour moi, sans financement. "Ma vie est mon message", disait Gandhi. En ce qui me concerne, cette façon de voyager, c'est ma vie, ma façon d'être au monde.
Chroniques sud-africaines
J-1
La nuit va être courte pour moi. Demain, aux aurores, je m'en vais construire une nouvelle vie. J’ouvre une voie nouvelle d'exploration de ma propre vie. Cape Town, un nouveau cap à franchir !
Trois îles et un continent
Le réveil a été difficile, je n’ai dormi que quelques heures. Il est cinq heure du matin. J’ai dû me résoudre à n’emporter que la moitié des livres que je comptais lire pendant mon séjour. Je n’ai droit qu’à une bagatelle. Comment tenir neuf mois avec si peu d’affaires ? J’ai préféré prendre mes livres, mon appareil photo, trois ou quatre objectifs, quelques uns de mes disques durs, mes deux ordinateurs et qu’importe le reste. J’ai quelques vêtements bien sûr, mais rien de superflu.
Durant plusieurs mois, j’ai acheté des livres, pour me constituer une base solide sur les sujets que j’aborde dans l’un des livres que j’ai commencé à écrire. J’ai dû me résoudre à abandonner mon précieux butin — en attendant de le retrouver provisoirement, en décembre. Un douanier n’y verrait que du feu. Tous ces livres semblent n’avoir aucun rapport entre eux et, pourtant, je suis le seul à connaître les liens invisibles qui les relient au fil de ma pensée. Séparément, tous ces ouvrages semblent inoffensifs, et pourtant, le pouvoir des idées est aussi spectaculaire qu’une réaction en chaîne.
Bien sûr, je me suis empressé de prendre « L’invention de la réalité », de Paul Watzlawick, dont le sous-titre à lui seul vaut tous les détours : « Comment savons-nous ce que nous croyons savoir ? ». J’ai laissé « Changements ». Ce livre a si fortement révolutionné ma vie qu’il m’a nourri pour le restant de mes jours d’une vision claire sur ces mécanismes, qui font ou empêchent le changement. Et puis, je ne pouvais pas partir sans emporter « Qu’est-ce que la Préhistoire ? », de Sophie Archambault de Beaune. J’ai déjà lu ces deux ouvrages, mais ils m’auraient manqués si je ne m’étais octroyé le luxe de pouvoir les relire à mon aise. Évidemment, je ne pouvais pas abandonner « Les désorientées » que m’avait offert David Gagneur, quelques jours avant mon départ. Ce roman d’Amin Maalouf me rappellera nos discussions passionnantes à l’Iconothèque historique de l’Océan Indien. Viennent ensuite « Les nouveaux maîtres du monde » de Jean Ziegler, « La Décision » d’Alain Berthoz, « Du vrai, du beau, du bien », de Jean-Pierre Changeux, une étude sérieuse de Marcel Hénaff sur « Claude Lévi-Strauss et l’anthropologie structurale », « Humain, une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies », de Monique Atlan et Roger-Pol Droit, « L’événement Anthropocène » de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, l’indispensable « Initiation à la philosophie », de Roger Caratini, « Un si brillant cerveau » du Docteur Steven Laureys, le fabuleux ouvrage de Timothy Brook « Le chapeau de Vermeer », mais aussi « Les Africains. Histoire d’un continent », de John Iliffe, le très instructif « Géopolitique des conflits » d’Amaël Cattaruzza et Pierre Sintès, et pour compléter le tableau, le classique « Psychologie sociale » de Serge Moscovici, ainsi que « L’homme en développement » de Jacqueline Bideaud, Olivier Houdé et Jean-Louis Pedinielli. Ah! J’allais oublier l’ impressionnante synthèse de Lucien R. Karhaussen, « Les flux de la philosophie des sciences au 20e siècle ».
Cela fait un paquet de clandestins qui m’accompagnent en douce. Et encore, je ne compte pas les versions numériques des ouvrages que j’ai téléchargés sur Internet. Ce n’est pas pour en imposer que j’ai cité tous ces auteurs, mais il faut bien rendre à César ce qui est à César. Ma formation d’historien y est sans doute pour quelque chose. En m’apprêtant à partir avec tout cet équipage bourré tant bien que mal dans ma valise, c’est la promesse d’un dialogue soutenu avec eux que j’embarque avec moi, en les traînant incognito sur des roulettes au milieu d’un aéroport a demi-éveillé. Toutes ces pages qui ont tant à m’apprendre, comment aurai-je pu les abandonner à leur sort ? Le choix que j’ai opéré n’est pas si éclectique qu’il n’aurait pu l’être. Il me fallait n’emporter que ce qui me semblait utile à l’avancée de mes travaux. Mais quiconque a déjà écrit un livre, sait que le hasard est une source d’inspiration plus nourrissante qu’un programme bien ordonné. Rien ne me satisfait plus que de passer d’un livre à un autre, surtout lorsque rien ne semble les rattacher d’une manière quelconque. Je n'essaie pas de créer une succession chronologique au fil de mes lectures, comme les couches superposées d’un millefeuille, mais plutôt de relier des livres lus et parfois oubliés, à d’autres, plus récents, et dont le dénominateur est toujours un lien presque invisible que je perçois, en écoutant leurs résonances, et en les rassemblant les uns aux autres dans une construction mentale, digne de celle que décrit Hermann Hesse dans Le Jeu des Perles de Verre. Mais n’est-ce pas ainsi que la mémoire et l’imagination s’épousent en chacune de nos réflexions ?
Mes parents sont venus m’accompagner. Ma mère reprendra elle aussi l’avion dans quelques semaines pour rentrer à Cagnes-sur-Mer, où elle est retournée vivre depuis quatre ou cinq ans en attendant de vendre la maison. Mon père est là, lui aussi. Ces dernières années nous ont tellement déchirés l’un et l’autre que nous n’avons plus grand chose à nous dire, sinon qu’un bref au revoir. Je crois même que nous vivons ce moment comme une libération réciproque du clavaire que chacun imposait à l’autre. Plus rien ne nous réunit vraiment, si ce n’est qu’un reste d’amour paternel et filial usé jusqu’à la corde. Nos personnalités, nos manières d’être et d’agir, divergent tellement que toute communication entre nous s’est amenuisée au fil du temps, pour n’en garder qu’une fragile apparence — lorsqu’elle n’était pas excitée, à l’occasion, par de violentes disputes. Nos reproches mutuels se sont figés en récriminations, en méfiances subtiles, pour finalement aboutir à une sorte d’armistice. Chacun son territoire et ses occupations, et, lorsque la nécessité nous obligeait à partager nos repas, ou en d’autres occasions, nous n’assurions un service minimum que par commodité.
Depuis longtemps déjà, les mots que nous utilisions pour nous parler avaient perdus leurs sens. Je l’écoutais se raconter, se vautrer dans son narcissisme, dans sa certitude absolue d’avoir contribué à l’histoire nationale. Mon père a effectué ses années de service dans les bureaux de l’administration des douanes. A ses débuts, il était au contrôle des frontières, à l’ouverture d’Orly, aux premières heures des années soixante. C’était le temps de la guerre d’Algérie. A l’écouter, tous les rapatriés lui sont tombés dans les bras, et ensemble ils pleuraient les malheurs de l’exil qui leur était imposés et auquel il compatissait. Mais mon père n’a jamais été attentif qu’à lui-même, en dépit d’un dévouement et d’une loyauté presque sans faille à sa famille. Ses logorrhées, ces dernières années, étaient imbues de l’idée surestimée qu’il se faisait de lui-même. Mon père restera toujours une énigme pour moi. Débordant d’énergie, comme ma mère, il a toujours su gérer son temps, mieux que quiconque, pour abattre son travail. Débrouillard comme pas deux, il a toujours mené sa barque, commentant tout de même quelques bourdes monumentales. Incapable d’assumer ses erreurs ou ses infidélités, il a préféré rester, mais lentement, les années l’ont changé. La retraite lui a permis de retrouver une seconde jeunesse. Malheureusement, il n’a jamais su dire ces mots essentiels qui soulagent les peines et libèrent le chagrin. Convaincu de n’avoir jamais rien à se reprocher, pourquoi quémanderait-il l’indulgence de ceux qu’ils blesse ? Son caractère rieur l’a toujours incité à prendre les choses à la légère. D’ailleurs, sa vie n’est qu’une farce, une pantomime, dont il a le secret. Malgré son âge avancé, il a gardé la vitalité et les aspirations d’un éternel adolescent en quête de reconnaissance. Noceur dans l’âme, il impressionne son monde par son aisance naturelle, son énergie de buffle, sa force de travail. Mais que l’on s’entende bien, mon père n’est pas un adepte des clubs troisième âge qu’il méprise ouvertement. Il a sa façon bien à lui de jouir de ce regain d’énergie. Pour vivre longtemps, mieux vaut fréquenter les jeunes pousses que les déjà-presque-morts. Il possède ses entrées dans les discothèques les plus huppées, où on lui pardonne son âge. Sa vie, où ce qu’il lui en reste, il veut la vivre à la lumière des projecteurs, dans le sillage de ceux qui ne savent pas encore que le temps s’attelle déjà à rompre leur jeunesse.
Aux yeux de mon père, j’ai perdu mon temps ; gâché la moitié de ma vie, car je n’ai pas su comme lui, mener une carrière et gagner suffisamment d’argent pour devenir quelqu’un. Ma mère n’est pas loin de penser la même chose, mais elle sait au fond d’elle qu’il y a en moi quelque chose qui est en germe. Elle a vu l’éclat que lui n’a pas su voir. Pour lui, seuls les résultats comptent. Mais ma mère sait que je ne suis pas un garçon comme les autres, puisqu’elle m’a fait. Je fais partie de ces êtres qui nécessitent plus de temps et d’attention avant de déployer leurs ailes. Même si j’ai su prouver depuis longtemps ma capacité à être autonome, je n’ai pas encore exprimé, ici bas, tout ce dont je suis capable. Je ne suis ni moins bien ni meilleur que les autres. Je suis différent, simplement parce que je ne suis pas conforme à l’idée que la majorité ce fait de ce qu’elle doit être. J’ai quarante cinq ans, un doctorat d’histoire en poche qui ne me sert pas à grand chose, puisqu’en tant que photographe, j’exerce un métier ingrat, sans talent particulier, et que pour m’en consoler, je n’ai pas même été fichu d’avoir une femme et des enfants. Et, pour couronner le tout, je m’apprête à larguer les amarres pour courir le monde… J’avoue que si j’étais à la place de mes parents, moi aussi j’aurai eu le droit de me poser certaines questions. Mais je suis ce que je suis, parce que j’ai choisi la vie que je mène, dans chacun de mes choix. D’une graine de baobab ne peut surgir un chêne, pas plus que d’un bouton de rose ne peut éclore un trèfle à quatre feuilles. J’ai choisi la liberté plutôt que la sécurité, et ce, délibérément. Telle est ma faute !
Ma mère est là, qui regarde son fils partir. Et je la regarde qui me regarde m’éloigner. Cette mise en abîme suscite en moi un léger vertige, c’est donc vrai que je m’en vais ? Je quitte cette île où je suis né, je laisse mes parents, mes amis, j’abandonne cette vie d’avant, je me défais de moi-même, de cette chrysalide qui m’étouffait. Mon départ pour l’Afrique du Sud ne fait que réparer une entorse au cours des choses. J’aurai dû fuir depuis longtemps.
Ma mère est là, cette femme admirable, qui m’a porté, puis donné vie, et qui maintenant me voit se détacher d’elle comme un fruit tombant de l’arbre. Nous savons bien tous les deux qu’il est temps que j’entame ma vie, que je la fasse complètement mienne. Je n’ai plus à lutter pour préserver un semblant d’existence familiale. J’étais revenu chez mes parents par fidélité, pour empêcher que les murs ne s’effondre, alors qu’ils étaient déjà lézardés de toute part. Si je n’avais pas pris ma décision, et surtout, si je ne l’avais pas mise en oeuvre, j’aurai été enseveli par une obéissance idiote. Qu’on fait mes ancêtres, sinon fuir leurs misérables existence en quête d’une vie meilleure ? Je porte en moi l’appel du voyage, comme un atavisme. Je dois moi aussi traverser les eaux noires, pour aller encore plus loin. J’en ai eu l’intuition enfant. Je savais que ma vie ne pouvait, ni devait, se liquéfier sur place. Il y a tant de choses à voir, tant à découvrir. Tous ces êtres, qui, ailleurs, ont tant de secrets à m’enseigner, comment pourrai-je les respecter si je ne venais m’incliner vers eux ?
Je passe le portique de sécurité, comme un acteur quittant la scène. Mes parents sont de l’autre côté, ensemble, dans une solitude dont ils ne peuvent se consoler l’un l’autre. J’ai franchi le seuil de non-retour. Je ne les vois plus. Je suis seul, face à moi-même. La salle d’attente n’est pas encore assaillie de ces cohortes d’oiseaux migrateurs, qui vont et viennent d’un hémisphère à l’autre.
Je ne tarde pas à embarquer… Direction l’Ile Maurice, où après une brève escale je changerai d’appareil pour Le Cap. Notre monde a bien changé en quelques décennies. Combien de fois mon père m’a-t-il raconté son voyage en Super Starliner, lorsqu’il était partit travailler à Paris à l’aube de ses vingt ans ? A cette époque, les avions cabotaient encore d’une escale à l’autre, alors qu’il suffit de moins de 24 heures de nos jours, pour rejoindre n’importe quel point du globe. Déjà, en 1939, dans Terre des hommes, Saint-Exupéry, décrivait les profonds changements qu’il constatait à son époque : « Notre psychologie elle-même a été bouleversée dans ses bases les plus intimes. Les notions de séparation, d’absence, de distance, de retour, si les mots sont demeurés les mêmes, ne contiennent plus les mêmes réalités ». Depuis, ce mouvement n’a cessé de s’amplifier. Aujourd’hui, où que nous soyons, sans même avoir besoin de sortir de chez soi, nous sommes reliés instantanément les uns aux autres. Une myriade de satellites lancés dans une course effrénée autour de la Terre relayent nos conversations téléphoniques et nos échanges informatiques à la vitesse de la lumière. Scrutant la surface du globe dans ses moindres recoins et épiant nos déplacements avec une précision de carte d’état-major, cette armada technologique a pris au piège la planète, comme se retrouve prisonnier du désir le buste d’une femme comprimé dans son corset.
Aux progrès des transports et des communications, s’ajoutent d’autres modifications tout aussi radicales. En moins d’un siècle, les langues les plus étranges et les plus anciennes ont disparu par centaines au profit de celles, peu nombreuses, qui ont cimenté les empires défaits, mais qu’emploient encore des milliards d’individus, qui semblent se comprendre en habitant, pourtant, des mondes aussi éloignés que ne le sont les galaxies entre elles. La mondialisation des échanges commerciaux a modelé le catalogue de nos désirs en favorisant la standardisation de nos besoins, de nos goûts et de nos centres d’intérêts. Les frontières sont-elles devenues plus perméables et les distances raccourcies pour que nous puissions, en toute saison, nous approvisionner en fruits ou en légumes, mais aussi en objets manufacturés de toutes sortes ? L’Homme moderne est un consommateur insouciant des pesanteurs du réel. Pour lui, la modernité ressemble à un jardin d’Eden, où le bonheur consiste à cueillir les fruits les plus inutiles de ses envies en poussant son caddie dans les allées des supermarchés bondés.
Dans les limbes de ce paradis, les ethnies les plus esseulées se replient au creux des forêts que massacrent les tronçonneuses et les engins de terrassement. Des routes s’enracinent là, où jadis, aucune civilisation n’avait triomphé de la jungle. Partout, le progrès s’installe, terrassant ces hommes armés de lances et de flèches, qui n’ont pas vu passer le temps, et pour qui, maintenant le temps est compté. Au milieu des déserts, plantées comme des bouquets de fleurs artificielles et vénéneuses, des villes futuristes s’érigent en point de mire, plus crânement que la tour de Babel. Partout, l’écorce terrestre se fissure de routes encombrées de voitures ou de camions ; de lignes ferroviaires labourant les plaines inondées de banlieues, de friches urbaine et de campagnes abandonnées… Au large des continents, des cargos indolents comme des fétus de pailles drainent leurs containers de marchandises, ballotés au milieu des océans, tandis que des chalutiers raclent les fonds marins en trainant leur nasse comme un voile de mariée. A 10 000 mètres d’altitudes, filant d’une mégapole à l’autre, des avions dessinent à la craie blanche des lignes éphémères sur un tableau délavé par la course des vents. Ces caravelles à la carlingue d’acier écument les cieux, comme autrefois les navires en partance sillonnaient les océans les cales remplies d’or, de poivre ou d’esclaves.
Pour les voyageurs comme moi, qui aiment rêvasser le nez collé au hublot, il n’est pas de spectacle plus émouvant que celui de ces longs trajets au milieu des nuages, où l’on aperçoit, lorsqu’il fait nuit, les étoiles et la lune se mélangeant aux lueurs des villes, ou, en plein jour, des terres et des mers baignés d’une douce lumière aveuglante, lorsque le soleil exulte encore. Il est encore tôt, ce matin, lorsque je m’envole vers Cape Town. Comme l’avait compris Saint-Exupéry, ce vieux renard des airs, « L’avion est une machine sans doute, mais quel instrument d’analyse ! Cet instrument nous a fait découvrir le vrai visage de la terre ». Les descriptions poétiques de ces terres exotiques, de ces montagnes aux versants abrupts ou de ces déserts enflammés, qu’il a effleuré dans le tangage de son cockpit, font partie de ces pages enivrantes, qui donnent à la littérature toute sa noblesse.
Jamais, je ne saurai décrire des paysages avec des mots, puisque toute description quelle qu’elle soit m’est difficile à réaliser. C’est sans doute, pour cela que je suis devenu photographe, pour satisfaire une paresse naturelle, où la chose à montrer parle pour elle-même.
L’avion commence sa descente avec souplesse. J’aperçois ce morne qui se dresse comme la pointe d’une citadelle escarpée. Le sable blanc et l’eau turquoise des plages s’apprivoisent dans le froissement des vagues, dont l’écume forme un ourlet évanescent autour du rivage. Virant dans les terres, l’appareil croise une forêt d’émeraudes. Des conifères sages et patients nous regardent passer en rêvant de nuages chargés d’eau. Puis viennent les champs de cannes, délimités sobrement par ces chemins qui ont gardé en mémoire la trajectoire de ces hommes mangés par l’histoire.
Soumeya a déjà pris son poste à la Commission de l’océan Indien, à Quatre Borne, je crois. Elle est partie depuis quelques semaines déjà. La dernière fois que je l’ai vue, je lui avais offert un exemplaire du Loup des Steppes, de Hermann Hesse. A l’intérieur, au crayon de papier, d’une écriture fine j’avais écris cette dédicace :
« A travers ce livre, tu découvriras combien la complexité de l’âme humaine est sans fin, car la tension tragique qui s’exerce en nous, pour que nous devenions humains, est souvent d’une violence inouïe. Seule la culture - une culture ouverte et éclairée - peut nous sauver des ténèbres sauvages qui sommeillent en chacun de nous, car elle nous force à rompre avec nos certitudes, pour mieux découvrir dans l’altérité, ces reflets infinis de nous mêmes.
J’ai été heureux de contempler la pureté de ton âme et d’y déceler les richesses de ta pensée. Puisses-tu devenir une voix forte et éclairée, capable d’inspirer et de guider les esprits pour construire un monde de tolérance et de paix ».
Soumeya est une belle âme, encore jeune et fragile, et pourtant, déjà si forte. Lorsque nous revenions de nos semaines de formation, nous faisions la route ensemble et dans la voiture nos conversations étaient toujours des plus stimulantes. Hébergés au Tampon, nous formions une équipe d’une douzaine d’apôtres, appelés à répandre avec ferveur les bienfaits de notre mission de coopération régionale dans la zone océan Indien. Willy, David, Isabelle, Fanny, Teffy, Luv et Elodie avaient été affectés à Madagascar. Mirella aux Seychelles. Thomas, à Port-Elisabeth, en Afrique du Sud, et Valériane et moi, à Cape Town. Thomas s’envolera après moi et chacun de nous sera à sa place. Un point sur une carte. Le temps que fleurissent les flamboyants. Une année, ou presque, à l’étranger et la possibilité de renouveler le contrat pour une nouvelle floraison. Pour moi, le départ à quelque chose de plus définitif. Je ne reviendrais en décembre, lorsque les Flamboyant auront revêtus leurs couronnes de sang, que pour refaire mon visa et régler quelques détails pratiques avant de m’envoler à nouveau.
Le rugissement de l’avion retentit avec force. Le voilà qui défie les lois de l’apesanteur pour s’arracher au sol. Notre course a repris de plus belle. Je me rapproche de mon but, de cette terre sud-africaine dont j’ai tant rêvé. Ce voyage me projette vers une vie nouvelle, que j’ai choisie de vivre sans concession. Il n’y a rien à regretter, rien à redouter. Je vole vers l’horizon que j’ai choisi d’accoster, pour y vivre ma vie, quittant celle à laquelle j’ai refusé de me plier. Il n’y a ni lâcheté ni courage à suivre sa volonté. Je sais bien, malheureusement, que tous les hommes ne sont pas libres et égaux en droit. Mais, puisque je suis libre, devrais-je renoncer à ma liberté ? Non, je ne le puis ! J’entends jouir pleinement de cette liberté. Sinon, à quoi bon ? Je ne peux fouler aux pieds le sacrifice de ceux qui sont morts pour que d’autres jouissent de cette liberté à laquelle ils aspiraient. Je ne revendique pas ma liberté comme un dû, mais comme un devoir de mémoire et d’accomplissement. Je ne veux pas être libre pour échapper à mes devoirs. Je veux être libre de donner du sens à ma liberté, et donc à la vie qui est la mienne.
Par le hublot, j’aperçois la silhouette de mon île natale, qui se dessine comme une oasis dans un désert de vagues et d’embruns. Les terres brûlées du Piton de la Fournaise, parsemées de fumeroles, semblent si douces vue d’en haut. Je me souviens d’avoir survolé le cratère en feu, à bord d’un ULM, lors d’une éruption récente. Des jaillissements de lave projetaient un torrent qui se déversait du chaudron comme une soupe épaisse, visqueuse mais chatoyante. Pris de fascination pour ce réveil majestueux des forces ténébreuses de l’île, Stan, Ketty et moi, nous avions affronté la nuit glaciale et ses bourrasques, pour cheminer dans l’obscurité de la nuit, du Pas de Belcombe jusqu’au Piton Partage, où s’étendait l’enclos et sa chimère crachant ses gerbes de feu. Le souffle du monstre, haletant, concentré sur sa création, parvenait jusqu’à nous, et nous étions comme enivrés de ses relents de souffre. L’île n’était donc pas achevée. Nous en avions la preuve. Travaillant aux forges, cognant son marteau contre l’enclume dans un vacarme assourdissant, Vulcain, produisait dans les entrailles de la Terre de la matière nouvelle, promise à enrichir les sols, longtemps après que la chaleur se soit évanouie et que les pluies aient baigné ce trésor pour le rendre docile, prêt à laisser croître ces forêts cachées dans leurs graines.
Toujours à bonne distance des côtes, je reconnaissais maintenant le Sud sauvage, et plus loin, les ramifications tentaculaires de Saint-Pierre, du Tampon et de Saint-Louis, qui dans une pression constante s’évertuaient à former un maillage étroit où les droits de la ville l’emportent sur ceux de la campagne. Puis, apparut le lagon. C’est là, je crois que j’ai vu Stéphanie pour la dernière fois. Au coeur de la nuit, nous avions drapé le monde de nos visions. Tout était à refaire. Mais il restait une constante : la beauté seule valait la peine que l’on y sacrifie tout le reste. Jamais, cependant, nous ne pourrions franchir ce pas supplémentaire. Elle restera énigmatique et silencieuse, comme une Joconde auréolée de vertu. Tous les malentendus naissent du langage, de la confusion que sèment dans nos esprits des mots que nous ne comprenons qu’à moitié et qui ne sont jamais les mêmes lorsqu’on y repense. De tous, le pire est « l’Amour », qui se confond avec « le Désir », car l’un ne peut naître sans l’autre, du moins, lorsque l’on ne cherche plus à combler la chair d’un manque. Le lagon s’éloigne, noyant derrière lui le souvenir de ce regard mystique, de ce sourire que je n’ai jamais pu embrasser.
Et puis, soudain, surgit une déchirure. L’île était fendue, comme d’un coup de hache. Une fissure large et profonde, s’enfonçant loin dans son mystère… Une figue offrant sa chair ouverte, voilà ce à quoi ressemblait l’île. Le vide central, cette absence décisive et nécessaire, pour que l’on y glisse une langue assoiffée d’une perle de pluie, d’une larme sucrée.
Saint-Gilles et les manguiers de mon père, Le Port, La Possession… L’île s’évanouissait. Je faisais route vers l’ailleurs, vers une promesse, un engagement vis-à-vis de moi-même que j’étais enfin en mesure de tenir. Presque vingt ans plus tôt, ma mère m’avait demandé d’accompagner ma soeur en Inde. Elle voulait y partir en voyage, avec ses deux enfants. Elysée, l’aîné avait quatre ans, et Rivka, trois mois à peine. A cette époque déjà, nos relations s’étaient tendues. Je n’avais pas envie de voyager avec ma soeur, et encore moins d’aller en Inde. Mais, je savais qu’elle partirait de toute façon. Aussi, fixais-je mes conditions. Je proposais l’Afrique du Sud. Je ne l’avais pas réalisé à l’époque, mais ce choix était logique. Plus jeune, j’étais parti seul, sac au dos, pour sillonner l’Afrique. Hélas, ce voyage fut écourté au moment où il devait réellement commencer. A Izmir, deux larrons que j’avais rencontré m’avaient convaincu de les accompagner en Libye plutôt que d'aller au Caire. Nous devions prendre le bateau le lendemain. Mais, lorsque j’ouvris les yeux, au matin, j'avais un mal de crâne terrible. Mes deux voleurs avaient pris la poudre d’escampette depuis longtemps déjà, me laissant en pyjama, seul, dans les rues froides, mais chaleureuses, d’Izmir. Cela s’était passé cinq ans plus tôt, avant que ma soeur se ne décide à m’accompagner en Afrique du Sud, avec ses deux enfants. Cela ne changeait pas grand chose pour elle, puisqu’elle avait besoin de prendre le large, d’une façon ou d’une autre. Pour moi, ce changement de perspective était d’une importance capitale. En restant maître d’aller là où bon me semble, et non là où l’on me disais d’aller, j’assumais ma liberté, ma volonté, mon désir inconscient de renouer avec ce voyage inachevé.
Lorsque le hublot se remplit de cette terre rouge, je savais que nous survolions la Grande île. Madagascar. Je m’étais assoupi. Nous avions déjà traversé la moitié de l’île. Je scrutais cette terre étrange, emprunt de magie, mais qui vue d’en haut ne semblait plus qu’un corps gratté jusqu’au sang, une plaie pulvérulente. Mon ami Willy avait tenté l’aventure avec sa femme et sa fille. Ils étaient partis tous les trois. Nous nous étions dit au revoir longuement, et là, en survolant cette terre où ils s’étaient installés, je savais que dans quelques heures, je serai moi aussi, livré à ma responsabilité, acculé à la réalité de mes choix et de leurs conséquences. Un fleuve brunâtre vomissait sa diarrhée, loin des côtes malgaches. Ce pays était décidément mal en point.
Quelques navires tentèrent de nous accompagner, mais ils flairaient le poisson et se remirent bien vite à cueillir les fruits amers d’une pêche misérable.
L’avion se remit à bourdonner lentement. A l’horizon, rien d’autre que des royaumes de nuages perdus dans la solitude des océans, à perte de vue.
Après quelques heures de vol, où je m’étais laissé allé à un profond sommeil, j’ouvrais les yeux. La terre en bas ne ressemblait plus à aucune île. Nous avions abordé l’Afrique, ce continent tragique, situé au centre du monde, mais relégué à la périphérie de toute évolution historique, selon certains. Nous suivions le courant d’Agulhas, traversant le Kwazulu Natal ou le Eastern Cape. Un vieil Anglais, se penchant vers moi pour observer le paysage avec gourmandise, engageât la conversation. Sans doute un homme d’affaire ayant pris sa retraite. Quelqu’un de cultivé, d’intelligent et ouvert d’esprit, connaissant bien l’Afrique du Sud, puisqu'il y retourne tous les ans, pour rendre visite à son beau-frère. Mes premiers mots en anglais… Mes premières bafouilles. Et pourtant, comme toujours, nous nous comprenions…
Une montagne noire, figée dans son éternité minérale, s’effilochait en dessous de nous. L’on distinguaient, ça et là, quelques villes perdues. Nous survolions le Western Cape depuis un moment, approchant lentement de notre destination. Quarante-cinq minutes plus tard, l’avion effectua un virage et commença sa descente. L’ombre de l’Airbus 319 courait le long d’un township. Un alignement de maisons scrofuleuses, des blocs d’habitation délabrées, les prisons de la pauvreté. Des rues dévastées, couvertes de cratères, de carcasses de voitures. En dessous un paysage de guerre, de lutte, de résistance… Une bataille sans fin contre le dénuement. Une lutte de tous les instants pour survivre et qu’importe la dignité si l’on peut grappiller quelques restes. Même les lignées de maisons flambant neuves avaient encore l’air de baraquements pour criminels. La géographie ne ment pas. Les quartiers ont leurs propres logiques, leurs règles de grammaires pour conjuguer, selon les modes, la misère ou l’aisance. Des lignes invisibles divisent, séparent, cloisonnent, tiennent à distance, protègent, emmurent, illusionnent. A mesure que nous touchions au but, la pauvreté s’évanouissait, comme si jamais elle n’avait existé, cédant la place aux maisons avec piscine et jardin. Là, des hommes qui vivent comme des bêtes ; ici, ceux qui se croient libres. Et pourtant, les uns et les autres ne peuvent vivre les uns sans les autres. Ubuntu !
L’avion s’est posé. Il vient d'épouser la terre, pour nous ramener à la réalité des hommes.
Pressé par les autres voyageurs, qui veulent s'enfuir au plus vite vers leur destin, je sors de cette chrysalide de métal et dont les portes se sont enfin ouvertes ; le temps de l'éclosion est venu. Je récupère mes bagages et cette légion de clandestins, qui ont voyagé à fond de cale : Maalouf, Watzlawick, Levi-Strauss et tous les autres. J'attends dehors, mais je ne vois pas le Directeur de l’Alliance. Suis en avance ou en retard ? Je reviens sur mes pas. je l'aperçois enfin. Christian Pizafy me cherche aux milieux des passagers qui sortent encore. Je m’approche et je lui demande en plaisantant s’il attend quelqu’un. Son visage s’illumine, il me tend une franche poignée de main. Ca y est, tout commence. Je l’apprécie déjà. Il est venu m’accueillir avec sa femme. Ils m’invitent à manger. Nous nous installons dans un restaurant où l’on sert, paraît-il, d’excellents fruits de mer. La serveuse, un peu malhabile, nous apporte de grandes casseroles des poêlées de crevettes, de moules et de calamars. Je me délecte. Christian respire la vie, l’énergie, un appétit insatiable de rencontre et de discussion. Pour cet homme là, je suis prêt à travailler, à soulever des montagnes, puisqu’il a une force de conviction sans pareil.
Le repas fini, nous nous installons dans sa voiture, et nous voilà sur la route. Nous effleurons les ghettos et leurs faces présentables… Ces alignements de bâtisses neuves, qu’un souffle suffirait à ébranler. Des clôtures de chaque côté de la route, pour marquer les territoires. Interdit de s’arrêter, sous quelques prétextes que se soit. Il faut rouler droit, filer devant soi, ne pas regarder par les fenêtres…
La ville se dessine, les montagnes aussi. D’abord, ces arbres, ces pins, qui s’élancent outrageusement, pour attraper le soleil. Puis, le port et la voie ferrée… Les immeubles… Les rues… Nous sommes dimanche. Cette ville est déserte. Où sont les hommes ?
Nous passons devant l’Alliance, le berceau de ma nouvelle vie. Puis, Christian me dépose, un peu plus loin au 91 Loop Street, c’est un backpackers où j’ai réservé une chambre…
Je suis surpris par son air enjoué, qui tranche avec l’attitude glaciale qu’elle avait adoptée la dernière fois que nous nous étions vus, avant le départ. C’était dans l’hémicycle du Conseil départemental, où nous étions appelés à témoigner devant un parterre de candidats potentiels aux prochaines migrations. Nous faisions figures de sages, d’élèves modèles rencontrant les petits nouveaux, qui allaient s’évertuer à suivre notre exemple. Depuis notre formation, au Tampon, Valériane s’était montrée réticente, froide, hostile parfois vis-à-vis de moi. Mais elle avait aussi essayé de se montrer plus agréable, sans que jamais nous n’ayons pu réellement sympathiser. Ce traitement de faveur m’était réservé. Je n’ai jamais vraiment compris pourquoi et je dois avouer que cela m’a profondément perturbé avant le départ. Devrais-je l’affronter à Cape Town, comme l’on affronte une ennemie, alors même que nous étions sensés travailler de concert ? Ce n’est pas vraiment ce que j’espérais. L’un de nos formateurs, un être formidable, dont j’ai appris plus tard qu’il était décédé peu de temps après notre formation, nous avait sensibilisé à la résolution des conflits. Il travaillait beaucoup avec les jeunes en difficulté et nous faisait part de son expérience avec une grande sagacité. Lorsqu’il nous expliqua un jour, que les conflits n’étaient le plus souvent que l’expression de tourments inconscients, qui poussaient au moins l'un des belligérants, à projeter sur l'autre, sans raison apparentes, toute l'acrimonie dont il pouvait faire preuve, je compris que la réalité du conflit créé par Valériane relevait de quelque chose qui m’échappait, mais dont je n’étais pas responsable, du moins, pas consciemment. La chose n’était pas passée inaperçue. Thomas, Someya, Willy et même Mirella étaient surpris qu’elle puisse se comporter aussi sèchement. Un jour où elle se montra particulièrement exécrable, elle m’appela ensuite sur mon téléphone, pour me demander si nous pouvions discuter chez elle. La discussion s’engagea sur la terrasse de la petite maison qu’elle occupait provisoirement. Elle me présenta d’emblée ses excuses, que j’acceptais aussitôt. Pensant que le moment était propice, j’en profitais pour mettre à plat quelques remarques qui se voulaient constructives, pour que nous n’ayons plus à résoudre ce genre de situation dans l’avenir. Mais, alors que je n’y attendais pas, Valériane soudain me demanda d’une voix faussement ingénue, si j’avais l’intention, du haut de mes quarante cinq ans de lui apprendre, à elle, une jeune-fille d’une vingtaine d’année, ce qu’est la vie ? Elle avait réussit en une seconde à détourner l’ensemble de mes propos pour en faire un acte d’accusation. Je me levais d’un bond, sans dissimuler ma colère, et je lui dis que cette conversation n’avait plus lieu d’être. Je m’apprêtais à partir, mais surprise par ma réaction, elle se radouci et m’invita à me calmer. Puisque nous ne pourrions espérer devenir les meilleurs amis du monde, nous décidâmes d’adopter une attitude professionnelle, où la communication se limiterait à sa stricte nécessité. La retrouver, ici, dans le même backpackers que moi était bien la dernière chose que j’aurai pu imaginer. Mais après tout, peut-être que notre dépaysement mutuel nous offrirait l’occasion de ne plus percevoir en l’autre une menace, mais une chance à apprivoiser.
Le réceptionniste me fit signe d’avancer. Valériane s’éclipsa. Je remplis les formalités, mais, au moment de payer, ma carte bleue ne semblait pas vouloir fonctionner. Allais-je me retrouver à la rue et sans moyen de paiement, dès mon arrivée ? Une certaine angoisse me traversa l’esprit, mais je restais calme. Qu’est-ce qui n’allait pas avec ce code ? Finalement, le manager intervint et procéda au paiement sans que je n’ai besoin de valider ce satané code. J’étais sauvé ! J’allais enfin pouvoir me reposer.
Je compris quelques jours plus tard que j’avais utilisé le code de ma précédente carte. Je fus soulagé d’avoir retrouvé la mémoire et mon pouvoir d’achat, qui faisaient de moi à nouveau un homme libre !
Still Water
Pourquoi aimons-nous ce que nous aimons ?
J'aime l'Afrique du Sud et cela depuis ma première visite en 1998. Mais en venant ici, je n’espère pas refaire le même voyage. A quoi bon ? Tout change si vite dans la vie : tous ceux qui vivent à nos côtés prennent des rides et deviennent différents par lassitude, les paysages que nous traversons tous les jours se transforment à notre insu, les pays que nous avons sillonné se sont métamorphosés et notre mémoire, elle aussi, nous joue des tours. Et puis, surtout, nous aussi nous changeons. Nous vieillissons autant que ceux que nous voyons prendre de l'âge, en oubliant que le temps s'acharne aussi à nous rendre différents de ce que nous fûmes, lorsque dans la fleur de l'âge, nous étions jeunes et beaux, promis à l'insouciante éternité des gens heureux.
Alors, comment aimer ce que nous aimons, puisque ce que nous aimons n'est plus fidèle depuis longtemps à l'image que nous en avions ? Tout s’étiole sans que nous n'ayons conscience du changement. L'illusion rassurante de la continuité est un tranquillisant pour les âmes sensibles.
Cette Afrique du Sud que je retrouve aujourd'hui ne peut plus être celle que j'ai connue, puisqu'elle a changé et moi aussi. Je le sais, et je ne m'en désole pas. Je n’ai aucune raison d’être désabusé. Ma joie est entière. Et s'il y a bien une seule chose qui ne peut me tromper, c'est que le goût de l'eau ici, est toujours le même. Ce goût limpide et pur de l'eau minérale. Cette eau n'a aucun arrière-goût. Dès la première gorgée, elle vous paraît si familière que vous savez au fond de votre âme qu'elle vous est restée fidèle. Vos artères n'ont certes plus la même vigueur, mais elle est toujours aussi bonne, aussi désaltérante, aussi douce et poétique, qu'il faut l'embrasser, à pleine bouche, en la remerciant de ne s’être pas mélangée à d'affreux colorants.
L'eau pure et cristalline du Cap vaut mieux que tout les cépages du monde, parce qu'elle seule a gardé ce goût de l'aube primitive. Et Dieu sait que le vin est délicieux ici !
Des millions d'années sont nécessaires à ce que le cycle s'achève et recommence sans cesse. Des montagnes à la mer, de la mer aux nuages, des nuages aux montages. Ce sont toujours les mêmes molécules qui s'assemblent et se reforment dans une variation infinie de combinaisons.
Ici, à Cape Town, le niveau d'alerte sur le manque d'eau est au niveau 3, sur les 5 que comporte cette échelle préventive. Sur les murs des salles de bains, du 91 Loop Street, on peut lire les consignes : "buvez plus de bières et moins d'eau". Moi, je n'aime pas la bière. La permanence de la permanence n'est plus une garantie d'avenir. Ce qui a toujours été ne sera sans doute plus.
L'eau de Cape Town n'est rien sans la lumière et sans la terre. Ici, les arbres croissent comme des coups de pinceaux sur une toile de maître, légèrement penchés par la force des vents, démesurément grands, à la mesure du continent.
La lumière s'étale sur la terre et sur les montagnes, comme une couche de peinture jaunâtre, légèrement diluée par le temps. Et le ciel se contente d'entourer la terre et la mer. L'air marin souffle gentiment dans les ailes des oiseaux, les poussant plus haut encore. L'azur de la ligne d'horizon, où se perd la silhouette des montagnes les plus éloignées, me rappelle les couleurs de la Baie des Anges.
J'ai marché de longues heures, à contourner cette montagne arasée en forme de table, où quelques dieux africains avaient dû jeter autrefois une nappe pour un festin mémorable. J'allais en suivant les marées où longtemps se sont échoués des navires aux cales gonflées de marchandises et d'épices. Combien d'hommes ont perdu la vie sur ces rivages trompeurs à cause d'une mauvaise tempête ?
Sur le Waterfront, là, où, les badauds se trainent, achètent et consomment plus qu'ils n'en ont besoin, des bateleurs animent la foule paresseuse mais prête à s’émouvoir. Un jeune asiatique, à la souplesse d'un moine shaoline, beau comme une divinité incarnée, marche sur du verre, avale des sabres en plastique et surtout défie les lois de la gravité en faisant danser une boule de verre, puis une autre tout au long de ses bras et de sa nuque. Plus loin, s’immobilise longuement un homme automate, que seul son regard espiègle trahi lorsqu'il se moque à sa façon de son public en capturant une main innocente venue lui glisser une pièce dans son chapeau.
[description à venir de ma prise de poste et des premiers jours de travail].
La mauvaise rue
Aujourd'hui, est un autre jour. Après mes heures de service, d'une journée bien remplie, je suis allé à un rendez-vous, sur Constitution Street. Je devais visiter un appartement. Déconvenue. Quartier sale et triste, inquiétant, même si le sourire de Mandela illumine la façade peinte d'une maisonnette abandonnée. La propriétaire ne vient pas. Elle a du retard. Au moment où je m'en vais, elle arrive. Je visite sa demeure. Insalubre dans une résidence sécurisée. Je m'en vais. Même si ma recherche n'a pas aboutie, au moins, j'ai vu cette autre réalité, celle que l'on aime pas voir d'habitude.
L'ombre de la nuit enveloppe Cape Town et ses alentours. Il ne faut pas que je traine. Le quartier est vraiment pourri. Suivre la direction de Signal Hill, c'est là que se trouve Loop Street. Je décide de couper au plus court. Mais suivre la bonne direction n'indique en rien que l'on atteindra la bonne destination. Je remonte la rue longeant le Parlement. Impossible de tourner à droite, pour rejoindre Long Street et donc Loop Street, qui est parallèle. Je poursuis. Et lorsque enfin j'aperçois une petite rue, qui étrangement s'appelle « Avenue street », tournant dans la bonne direction, je m'y engouffre pensant être sauvé. Cette seule pensée m'avait déjà condamné, car dès que l'on cède à la peur, les fauves tapis dans jungle sentent à dix mille lieues la chair épouvantée. Face à moi s'avance un couple. Pas de danger à priori, mais mon intuition me dit d'éviter d’avancer au milieu de ce couple qui se divise comme un fleuve pour mieux me prendre à son filet. J'esquive en me déportant sur ma droite, mais il est déjà trop tard. J'ai compris que le couple est en chasse et que je suis la proie dans cette avenue qui n'a rien d'une avenue, à part quelques arbres poussifs qui dorment depuis longtemps. Je suis seul, mais lorsqu'on est seul avec soi-même, on est toujours deux. Tout va très vite. Le fauve bondit sur moi, tandis que la lionne s’avance quelque part dans mon dos, il cherche à m'agripper, je m'échappe, il sort son couteau, qu'il ouvre lentement, mais ses yeux sont assoiffé du sang qu'il sent battre en moi et dont il veut se repaître. Tuer, pour lui, ce n'est qu'une vieille habitude, une seconde nature dont le regard glacial ne laisse aucune équivoque. Il veut m'imposer sa brutalité, parce que la bête sauvage qui est en lui ne connaît plus la douleur, ni la soif, ni la faim. Cela change de ces demandes polies de sans abris, qui vous remercient de les avoir écouté, même quand vous n'avez n'avez rien à leur donner. Mais lui, la bête, il ne demande rien, il s'octroie, il prélève son dû, comme autrefois ces bandits de grands chemins réclamant "la bourse ou la vie". Il me demande : est-ce que tu veux mourir ? Ce qu'il ne sait pas, c'est que ma peur n'est pas celle que l'on ressent lorsque l'on est face au frisson du dernier instant. Non, je n'ai pas peur de mourir, même si évidemment, j'ai peur d'avoir mal, d'être là, agonisant, alors que tout commence à peine et que je me sens enfin vivant ici. Non, je n'ai pas peur de la mort. J'ai eu peur de ne pas pouvoir vivre assez longtemps pour finir ce que j'ai à faire. Je refuse de mourir sans mon consentement. Je veux écrire mes livres, voir ces peuples dispersés qui malgré tout ce qui les opposent tissent notre humanité commune, je veux rencontrer cette femme qui me cherche quelque part, peut-être lui faire quelques enfants, et aussi, transmettre ma foi en l'humanisme, œuvrer d'une façon ou d'une autre, et à la mesure de mes forces, pour que ce monde soit un peu plus lumineux qu'il ne l'est aujourd'hui.
J'ai de bonnes raisons de vivre. Je l'ai toujours su, et sans doute aujourd'hui plus que jamais. Je n'ai pas le droit de mourir sans avoir achevé ma quête, et donc, sans avoir donné à ma vie, le sens que je lui donne. Je ne veux pas œuvrer pour une quelconque postérité. Je travaille pour moi, je suis l'artisan et le salarié de ma propre vie. Je suis en accord avec ma philosophie, avec mon regard sur le monde.
La pointe de son couteau contre ma vie ? Non merci. Ma vie est plus précieuse qu'une simple intimidation. Puisque j'étais seul avec moi-même, mon moi, m'a dit sagement, que te veux cet imbécile dont tu n'as déjà jouis ? Même s'il te prend ta vie, ta vie a déjà été meilleure que la sienne. Que peut-il vouloir ? Du respect, de l'attention ? Non, pas lui, il est trop mesquin pour cela, trop carnivore. Il lui faut de l'or. Encore et toujours de l'or. Accepte de perdre un peu, et tu sauveras tout le reste, l'essentiel. Je lui ai donné mon téléphone portable. Oui, je le lui ai donné, avant qu'il ne me le prenne. Pour lui, il n'y a pas de différence, puisqu'il a obtenu ce qu'il désirait. Pour moi, cela change tout. Il n'a rien pris que je n'ai voulu librement lui offrir. Ma vie contre un téléphone. Oui, certains bonheur n’ont pas de prix !
Dans la bousculade qui a précédé le don, j'ai senti mes jambes défaillir. J'avais trop marché et soudain, mes muscles se sont froissés. Tant pis ! Qu'importe cette douleur, j'ai sauvé ma peau.
N'être si peu de chose avant de naître, et n'être plus rien, après la vie, voilà donc le secret des Hommes.
Isidore et Donnie
En m'engageant dans Avenue Street, je n'avais qu'une idée en tête, rentrer chez moi au plus vite pour remettre en lieu sûr les 6000 Rands que j'avais dans la poche arrière de mon pantalon. Pourquoi se balader avec une telle somme alors que l'insécurité en Afrique du Sud est une des caractéristiques du pays ? Christian m'avait expliqué qu'ici, lorsqu'on visite un appartement et que l'on veut le retenir, il faut mettre des billets sur la table. Évidemment, il faut signer un contrat avec le propriétaire, mais cela permet d'éviter que l'appartement ne vous passe sous le nez, parce que quelqu'un d'autre a fait ce qu'il fallait et pas vous. Avant de partir, j'avais demandé à mes collègues ce qu'ils pensaient du quartier où se situait Constitution Street. Valérie m'avait dit de faire attention, car la gare qui était à proximité drainait des zonards peu recommandables. Mais Patricia, qui y avait habité, pensait au contraire que c'était un chouette endroit. Mais ici, tout est affaire de nuances. Constitution fait partie de ces endroits dont le nom correspond à deux réalités que seule sépare une ligne de démarcation invisible sur une carte. Quartier Blanc / Quartier Noir. Une seule Constitution pour un même peuple, mais en réalité, deux peuples distincts, qui se côtoient sans se mélanger.
J'étais prévenu et je m'attendais au pire. Le seul moyen de trancher l'affaire était d'aller voir par moi-même. En passant cette ligne invisible, je me suis bien rendu compte que ce n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. J'aurai dû partir plus tôt, au lieu d'attendre la propriétaire qui m'a joué un sale tour en me faisant attendre plus de quarante cinq minutes pour finalement m'annoncer que l'appartement était loué.
En remontant la rue qui longe le Parlement sud-africain, je sentais cette atmosphère étrange qui règne ici, et que j'avais déjà perçue à Durban, lors de mon premier voyage. Les vivants rentrent à toute allure se terrer dans leurs foyers protecteurs, tandis qu'une faune patibulaire se réveille à la tombée du jour. Je marchais à vive allure, avec l’assurance d’un skieur slalomant entre les obstacles. Puis, en passant près de ce restaurant très chic, où plusieurs personnes prenaient un verre, alors qu’un peu plus loins de jeunes cadres blancs discutaient dans la rue, je sentais que je sortais de la zone de turbulence. Aussi, en m'engageant dans Avenue Street, je savais que Long Street n’était plus qu’à quelques encablures. Je l'ai d'ailleurs vérifié le lendemain, en refaisant un bout du chemin, avec ma collègue Valériane. Le plus navrant, c'est que le Consulat de France n’était qu’à deux pas de là.
Après avoir cédé mon portable, j'ai rebroussé chemin, espérant retrouver les jeunes cadres qui discutaient à l'angle de la rue. Mais un individu malfamé venait vers moi, j'ai cru qu'il s'agissait de mon joueur de couteau, j'ai donc tourné les talons. Je me suis approché d'un de ces hommes qui gardent les rues, vêtus d'un de ces gilets jaunes fluorescents, très moches mais qui sauvent des vies sur les routes en pleine nuit. En m'approchant, je vis un visage buriné par les coups de la vie, un regard tout aussi glaçant que celui de mon apprenti tueur. Une hésitation. Puis-je demander de l'aide à cet homme ? En deux mots, je lui explique la situation. "Fucking bastard" jargonne-t-il à l'encontre de mon agresseur. Son accent est à coupé... au couteau ! J'ai cru d'abord qu'il parlait afrikaans. Un autre patrouilleur nous rejoint et nous voilà à la poursuite du chasseur. Tous deux ont des visages de repris de justice, de bagnards à qui la vie n'a rien épargné. Ils savent se battre à mains nues, recevoir des coups et les éviter. Mais ils ont choisi la voie de la rédemption, celle du service, du respect de l'ordre. Eux, ne sont pas des voyous, peut-être l'ont-ils été plus jeunes, mais à présent, leur dévouement est indiscutable. Ils ont choisi d'assurer la sécurité de ceux qui étalent leurs signes extérieurs de richesse, sans mesurer à quel point l'ostentation est le vecteur de la tentation. Sont-ils au service de la Justice ? Assurément, puisqu'ils m'ont protégé en me raccompagnant jusqu'à Long Street. Mais quelle justice servent-ils ? Celle qui pousse à la rue des hommes et des femmes, parfois des enfants, dénués de protection sociale ? Combien d'épaves, de vies abîmées, de laissés pour compte croupissent au bord d'une société qui exulte au soleil ?
La pauvreté est une réalité propre à l'espèce humaine. Les animaux n'ont pas besoin de richesses ou de trésors pour vivre heureux. Certes, les prédateurs sont omniprésents dans le monde animal. Mais le besoin de manger chez les animaux ne les poussent pas à jouir de la douleur qu'ils causent en prenant une vie, et, encore moins à vouloir dépouiller leurs victimes de leurs biens pour se croire un peu plus riche. Bien sûr, cette misère est répandue, depuis toujours, sur la Terre, comme une lèpre souterraine, qui engendre cette violence, que l'on redoute en voulant protéger ce que l'on possède, alors que les autres, la très grande majorité ne possède rien d'autre qu'un désir d'exister, tout aussi légitime. Au fond, notre folie n'est-elle pas d'accepter la folie du monde comme une chose ordinaire ?
Mes anges gardiens m'ont demandé si je pouvais reconnaître l'homme au couteau. Ils m'ont accompagné dans Compagny's gardens. Nous n'y avons vu que des damnés dormant sous des tentes dans le meilleur des cas, et à la belle étoile, lorsque l'infortune était à son comble. Ils voulaient l'attraper, le cogner dur, lui montrer à ce « bastard » que nul ne peut défier impunément l'ordre des riches. Ils voulaient lui faire la leçon, pour le corriger de ces errances et justifier ainsi leur maigre salaire.
Avant de nous séparer, le visage d'Isidore et de Donnie s'est éclairé à la lueur d'un lampadaire, lorsqu'ils ont prononcé leurs prénoms. J'ai vu alors dans leurs yeux, qu'il suffisait de peu de choses pour qu'ils puissent s’enorgueillir, eux aussi, d’être apparenté à la communauté humaine.
L’origine de la violence
« Aucune race n’est supérieure à une autre. Depuis la préhistoire, c’est toujours le rapport de force qui décide de qui est le maître et de qui est le sujet. Aujourd’hui, la force est de mon côté. Et même si je ne suis à tes yeux qu’un taré de nègre, c’est moi qui mène la danse. Aucun savoir, aucun rang social, aucune couleur de peau ne pèse devant une vulgaire pétoire. Tu te croyais sorti de la cuisse de Jupiter ? Je vais te prouver que tu n’es qu’un avorton comme nous tous, sorti d’un trou du cul. Tes titres universitaires comme ton arrogance de Blanc n’ont pas cours là où une simple balle suffit à confisquer l’ensemble des privilèges. Tu es né en Occident ? T’as de la chance. Maintenant, tu vas renaître en Afrique et tu vas comprendre ce que cela signifie ». Je viens de reposer sur la table le roman de Yasmina Khadra. L’équation africaine. Sur la couverture du livre de poche, le visage d’une femme africaine couverte d’un voile chamarré. A la manière de Mona Lisa, ses yeux ardent semblent me fixer d’un regard auquel je ne peux échapper. D’un geste de la main, elle recouvre sa bouche, comme pour taire son immense tristesse et celle de toutes les femmes du monde qui, comme elle, ne connaissent rien des plaisirs superflus qu’offre la modernité.
Demain, cela fera un mois que j’ai croisé le regard assassin de celui qui m’a initié à l’hospitalité africaine. J’ai failli mourir dans d’autres occasions, notamment dès les premiers jours de mon voyage en Asie du Sud-Est. A Bangkok, un autobus filant droit comme un missile a bien failli me réduire en bouillie. Mais, ici, à Cape Town, pour la première fois de ma vie j’ai croisé le regard d’un tueur. J’ai appris ma leçon et j’en suis heureux, car il n’y a que ceux à qui il n’arrive jamais rien qui n’ont rien à raconter. Ce soir encore, Christian et Patricia évoquaient, consternés, la mésaventure d’un photographe français, qui la veille de son retour, s’est aventuré seul dans un ghetto. Lorsque les agents du consulat l’on récupéré sur place, il était en slip, mais encore vivant, ce qui tenait presque du miracle pour une telle imprudence. Quelques semaines plus tôt, grâce à son sang froid, Paul, le fils de Patricia, avait échappé lui aussi, sans une égratignure, à une quinzaine de Noirs patibulaires, prêts à commettre l’irréparable en s’en prenant à lui et à l’une de ses amies, dans un parc de Johannesburg, où il vit depuis plusieurs années.
L’initiation est un rite de passage, un moment d’apprentissage où l’on se dépouille de son arrogance ou de sa naïveté pour faire preuve d’humilité, mais à condition ne point s’en lamenter. La victime clame son innocence, révulsée de l’injustice qui lui a été infligée. Mais moi, j’ai choisi d’assumer mes actes, j’ai choisi d’aller au bout de leur logique, sans pour autant provoquer ce qui m’est arrivé. C’est arrivé. Voilà tout ! Cela arrive tous les jours, partout ailleurs dans le monde, et je ne crois pas que l’Afrique soit un continent plus sauvage, plus brutal qu’un autre. C’est la nature humaine qui porte en elle cette infamie, cette soif du mal, surtout, quand la richesse se moque éperdument de la dignité de ceux qu’elle méprise. Poussés à bout, exclus du festin, ceux qui montrent les dents ont le même appétit que les convives, à ceci près que leurs ventres à eux restent désespérément vides. Suis-je en train d’absoudre cette racaille qui m’a pointé son aiguille sous le nez ? Non. Les choses sont ce qu’elles sont. Mais il nous faut apprendre à vivre avec elles. Chaque leçon de vie qui n’est pas apprise se répète inlassablement. Je ferai d’autres erreurs et j’apprendrais, sinon, à quoi bon vivre ?
J’ai compris aujourd’hui, que ceux qui tiennent les armes ne sont pas les plus forts. Tous les hommes ont peur. Certains ont peur de perdre la vie, d’autres de mourir et quelques uns redoutent, tout simplement, de vivre. Mais quelle différence réelle y a-t-il entre celui qui tient une arme et celui qui est visé ? L’un à le pouvoir de tuer l’autre, sans que la réciproque ne soit tout à fait vraie. Mais au-delà de cette apparence, qu’y a-t-il de réel ? Je crois qu’il n’y a pas de différence. Tous les hommes sont mortels, mais ceux qui pointent le canon de leurs armes sur des poitrines désarmées ont une peur plus grande de la mort. C’est pour tromper cette peur, qu’ils se parent de lames de couteaux ou de poudre et d’acier. Chaque poing brandissant une arme revendique une angoisse enfouie, qui se déchaîne, indomptable et outrancière. Cette démonstration de force n’est en réalité qu’un aveu de faiblesse. Celui qui tient une arme se protège de sa peur, celui qui n’en a pas doit affronter la sienne à mains nues. Parfois l’un deux s’effondre, mais l’apparente victoire du plus fort n’est qu’une illusion. La mort de l’autre est une réalité, certes. Mais le temps rétablira l’équilibre. A la fin, tous les hommes finissent en poussière.
C’est la vie ! Mais n’est-il pas étrange que la peur de la mort réveille en nous cette violence reptilienne ? Pour conjurer la fatalité de sa finitude, l’assassin se venge sur une proie dont il espère qu’elle ne lui donnera pas trop de fil à retordre. Ces gestes sont une inlassable répétition d’actes ancestraux, un infini perfectionnement de l’art d’ôter la vie d’autrui. Il y a mille façon d’anéantir ses semblables et l’homme est un tueur né. L’origine de la violence est, sans doute, aussi lointaine que la lignée des hominidés. C’est un héritage préhistorique, ancré dans nos gènes, qui hante notre mémoire collective de scènes de pillages, de viols, de meurtres, de massacres assourdissants, de guerres homériques et d’exterminations pointilleuses. Toute l’Histoire humaine n’est que le récit sanglant de notre inventivité à créer de nouvelles armes sophistiquées, de nouvelles méthodes de destruction massive. Il n’y a pas d’Histoire sans cadavres. L’Histoire est une enquête quasi criminelle, une façon de rassurer les vivants du sacrifice des vaincus. D’une manière ou d’une autre, nous sommes les descendants de ceux qui commirent d’abominables massacres ou qui y survécurent. C’est bien cela qui étonne, cette capacité qu’ont les hommes à s’infliger les pires souffrances et, au bout du compte, à les surmonter.
La violence est pourtant bien plus que l’expression d’un rapport de force, d’une puissance physique. Elle exprime aussi, depuis toujours, la complexité de la relation que nous entretenons avec le réel et ses représentations symboliques.
Qu’un conseil d’administration décide d’un licenciement massif ou d’une délocalisation, et voilà que la vie de ceux qui s’étaient dévoués corps et âme à leur entreprise se retrouve broyée, pour de vagues considérations financières. Le bien être des serviteurs importent peu aux maîtres. Ces mêmes conseils d’administration votent pour que l’expropriation des faibles accroissent le rendement de leurs fortunes. Et bien, si des pipe-lines saccagent des terres sacrées, derniers sanctuaires de peuples autochtones, que peut-on y faire ? Le monde civilisé n’a triomphé qu’en faisant preuve de cynisme, pour toujours mieux satisfaire sa convoitise. Il n’y a pas d’alternative, proclame-t-il, à la marche du progrès. Toutes les raisons sont bonnes pour justifier l’oppression ; le droit est presque toujours l’allié du plus fort.
La puissance politique possède aussi ses propres motivations qui, souvent, défient les lois de l’entendement. L’implosion de la Syrie illustre malheureusement à quelles vilénies un dictateur est prêt à s’abaisser pour conserver un pouvoir de pacotille. Ne sait-il pas qu’un peuple fantôme agonise dans son royaume des ombres ?
Sur les champs de bataille, les hommes s’entretuent pour des raisons dont les véritables enjeux leur échappent complément, mais ils s’étrillent et agonisent, fiers comme des soldats, en respectant un code de l’honneur et une hiérarchie qui leur impose l’ultime sacrifice. La vraie puissance n’est donc pas au bout du fusil, mais dans l’obscur cerveau d’un chef de brigade, d’un général ou d’un empereur qui commande à ses troupes de tuer ou de mourir pour satisfaire ses ambitions personnelles, comme si sa vie avait plus de valeur que celle de ses hommes.
La violence à son paroxysme se confond avec la folie, sans doute, parce qu’elle émane d’une pulsion inconsciente, où la destruction de l’autre et de soi-même s’entremêlent. En éliminant l’autre, je me tue moi-même. L’autre est celui qui me reconnait en tant qu’entité distincte. Si l’autre n’existe plus, qui me dira qui je suis ? Les terroristes ont perdu depuis longtemps toute notion d’identité personnelle. Ils n’appartiennent plus au genre humain, mais à sa négation. C’est pour cela que la violence de leurs crimes nous effrayent tant.
Une société où règne l’ordre sans la justice est propice à la tyrannie, tandis qu’une société où la justice triomphe sans ordre favorise son déclin. Aujourd’hui, qu’un imbécile à demi-élu mette en péril l’idée même de démocratie, montre bien que notre civilisation a manqué de lucidité et de modestie sur le bien fondé de sa toute puissance et de son efficacité.
De la même façon qu'il n’y a pas d’Histoire sans cadavre, il n’y a pas de Civilisation sans violence… Et pourtant, notre héritage préhistorique ne se réduit pas à ce qu’il a y de plus obscur en nous. L’humanité a démontré ses dons exceptionnels pour la réalisation d’un véritable progrès humain, faisant place à la créativité, mais aussi à la solidarité et à la compassion… Nous sommes capables du meilleur, mais nous nous contentons du pire ! Y a-t-il une fatalité à cela ? Pouvons-nous encore changer notre nature humaine pour la rendre plus harmonieuse et plus respectueuse de la Vie ?
Nous ne pouvons devenir humain, qu’en acceptant de vaincre la peur et en nous ouvrant à l’amour.
La nuit va être courte pour moi. Demain, aux aurores, je m'en vais construire une nouvelle vie. J’ouvre une voie nouvelle d'exploration de ma propre vie. Cape Town, un nouveau cap à franchir !
Trois îles et un continent
Le réveil a été difficile, je n’ai dormi que quelques heures. Il est cinq heure du matin. J’ai dû me résoudre à n’emporter que la moitié des livres que je comptais lire pendant mon séjour. Je n’ai droit qu’à une bagatelle. Comment tenir neuf mois avec si peu d’affaires ? J’ai préféré prendre mes livres, mon appareil photo, trois ou quatre objectifs, quelques uns de mes disques durs, mes deux ordinateurs et qu’importe le reste. J’ai quelques vêtements bien sûr, mais rien de superflu.
Durant plusieurs mois, j’ai acheté des livres, pour me constituer une base solide sur les sujets que j’aborde dans l’un des livres que j’ai commencé à écrire. J’ai dû me résoudre à abandonner mon précieux butin — en attendant de le retrouver provisoirement, en décembre. Un douanier n’y verrait que du feu. Tous ces livres semblent n’avoir aucun rapport entre eux et, pourtant, je suis le seul à connaître les liens invisibles qui les relient au fil de ma pensée. Séparément, tous ces ouvrages semblent inoffensifs, et pourtant, le pouvoir des idées est aussi spectaculaire qu’une réaction en chaîne.
Bien sûr, je me suis empressé de prendre « L’invention de la réalité », de Paul Watzlawick, dont le sous-titre à lui seul vaut tous les détours : « Comment savons-nous ce que nous croyons savoir ? ». J’ai laissé « Changements ». Ce livre a si fortement révolutionné ma vie qu’il m’a nourri pour le restant de mes jours d’une vision claire sur ces mécanismes, qui font ou empêchent le changement. Et puis, je ne pouvais pas partir sans emporter « Qu’est-ce que la Préhistoire ? », de Sophie Archambault de Beaune. J’ai déjà lu ces deux ouvrages, mais ils m’auraient manqués si je ne m’étais octroyé le luxe de pouvoir les relire à mon aise. Évidemment, je ne pouvais pas abandonner « Les désorientées » que m’avait offert David Gagneur, quelques jours avant mon départ. Ce roman d’Amin Maalouf me rappellera nos discussions passionnantes à l’Iconothèque historique de l’Océan Indien. Viennent ensuite « Les nouveaux maîtres du monde » de Jean Ziegler, « La Décision » d’Alain Berthoz, « Du vrai, du beau, du bien », de Jean-Pierre Changeux, une étude sérieuse de Marcel Hénaff sur « Claude Lévi-Strauss et l’anthropologie structurale », « Humain, une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies », de Monique Atlan et Roger-Pol Droit, « L’événement Anthropocène » de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, l’indispensable « Initiation à la philosophie », de Roger Caratini, « Un si brillant cerveau » du Docteur Steven Laureys, le fabuleux ouvrage de Timothy Brook « Le chapeau de Vermeer », mais aussi « Les Africains. Histoire d’un continent », de John Iliffe, le très instructif « Géopolitique des conflits » d’Amaël Cattaruzza et Pierre Sintès, et pour compléter le tableau, le classique « Psychologie sociale » de Serge Moscovici, ainsi que « L’homme en développement » de Jacqueline Bideaud, Olivier Houdé et Jean-Louis Pedinielli. Ah! J’allais oublier l’ impressionnante synthèse de Lucien R. Karhaussen, « Les flux de la philosophie des sciences au 20e siècle ».
Cela fait un paquet de clandestins qui m’accompagnent en douce. Et encore, je ne compte pas les versions numériques des ouvrages que j’ai téléchargés sur Internet. Ce n’est pas pour en imposer que j’ai cité tous ces auteurs, mais il faut bien rendre à César ce qui est à César. Ma formation d’historien y est sans doute pour quelque chose. En m’apprêtant à partir avec tout cet équipage bourré tant bien que mal dans ma valise, c’est la promesse d’un dialogue soutenu avec eux que j’embarque avec moi, en les traînant incognito sur des roulettes au milieu d’un aéroport a demi-éveillé. Toutes ces pages qui ont tant à m’apprendre, comment aurai-je pu les abandonner à leur sort ? Le choix que j’ai opéré n’est pas si éclectique qu’il n’aurait pu l’être. Il me fallait n’emporter que ce qui me semblait utile à l’avancée de mes travaux. Mais quiconque a déjà écrit un livre, sait que le hasard est une source d’inspiration plus nourrissante qu’un programme bien ordonné. Rien ne me satisfait plus que de passer d’un livre à un autre, surtout lorsque rien ne semble les rattacher d’une manière quelconque. Je n'essaie pas de créer une succession chronologique au fil de mes lectures, comme les couches superposées d’un millefeuille, mais plutôt de relier des livres lus et parfois oubliés, à d’autres, plus récents, et dont le dénominateur est toujours un lien presque invisible que je perçois, en écoutant leurs résonances, et en les rassemblant les uns aux autres dans une construction mentale, digne de celle que décrit Hermann Hesse dans Le Jeu des Perles de Verre. Mais n’est-ce pas ainsi que la mémoire et l’imagination s’épousent en chacune de nos réflexions ?
Mes parents sont venus m’accompagner. Ma mère reprendra elle aussi l’avion dans quelques semaines pour rentrer à Cagnes-sur-Mer, où elle est retournée vivre depuis quatre ou cinq ans en attendant de vendre la maison. Mon père est là, lui aussi. Ces dernières années nous ont tellement déchirés l’un et l’autre que nous n’avons plus grand chose à nous dire, sinon qu’un bref au revoir. Je crois même que nous vivons ce moment comme une libération réciproque du clavaire que chacun imposait à l’autre. Plus rien ne nous réunit vraiment, si ce n’est qu’un reste d’amour paternel et filial usé jusqu’à la corde. Nos personnalités, nos manières d’être et d’agir, divergent tellement que toute communication entre nous s’est amenuisée au fil du temps, pour n’en garder qu’une fragile apparence — lorsqu’elle n’était pas excitée, à l’occasion, par de violentes disputes. Nos reproches mutuels se sont figés en récriminations, en méfiances subtiles, pour finalement aboutir à une sorte d’armistice. Chacun son territoire et ses occupations, et, lorsque la nécessité nous obligeait à partager nos repas, ou en d’autres occasions, nous n’assurions un service minimum que par commodité.
Depuis longtemps déjà, les mots que nous utilisions pour nous parler avaient perdus leurs sens. Je l’écoutais se raconter, se vautrer dans son narcissisme, dans sa certitude absolue d’avoir contribué à l’histoire nationale. Mon père a effectué ses années de service dans les bureaux de l’administration des douanes. A ses débuts, il était au contrôle des frontières, à l’ouverture d’Orly, aux premières heures des années soixante. C’était le temps de la guerre d’Algérie. A l’écouter, tous les rapatriés lui sont tombés dans les bras, et ensemble ils pleuraient les malheurs de l’exil qui leur était imposés et auquel il compatissait. Mais mon père n’a jamais été attentif qu’à lui-même, en dépit d’un dévouement et d’une loyauté presque sans faille à sa famille. Ses logorrhées, ces dernières années, étaient imbues de l’idée surestimée qu’il se faisait de lui-même. Mon père restera toujours une énigme pour moi. Débordant d’énergie, comme ma mère, il a toujours su gérer son temps, mieux que quiconque, pour abattre son travail. Débrouillard comme pas deux, il a toujours mené sa barque, commentant tout de même quelques bourdes monumentales. Incapable d’assumer ses erreurs ou ses infidélités, il a préféré rester, mais lentement, les années l’ont changé. La retraite lui a permis de retrouver une seconde jeunesse. Malheureusement, il n’a jamais su dire ces mots essentiels qui soulagent les peines et libèrent le chagrin. Convaincu de n’avoir jamais rien à se reprocher, pourquoi quémanderait-il l’indulgence de ceux qu’ils blesse ? Son caractère rieur l’a toujours incité à prendre les choses à la légère. D’ailleurs, sa vie n’est qu’une farce, une pantomime, dont il a le secret. Malgré son âge avancé, il a gardé la vitalité et les aspirations d’un éternel adolescent en quête de reconnaissance. Noceur dans l’âme, il impressionne son monde par son aisance naturelle, son énergie de buffle, sa force de travail. Mais que l’on s’entende bien, mon père n’est pas un adepte des clubs troisième âge qu’il méprise ouvertement. Il a sa façon bien à lui de jouir de ce regain d’énergie. Pour vivre longtemps, mieux vaut fréquenter les jeunes pousses que les déjà-presque-morts. Il possède ses entrées dans les discothèques les plus huppées, où on lui pardonne son âge. Sa vie, où ce qu’il lui en reste, il veut la vivre à la lumière des projecteurs, dans le sillage de ceux qui ne savent pas encore que le temps s’attelle déjà à rompre leur jeunesse.
Aux yeux de mon père, j’ai perdu mon temps ; gâché la moitié de ma vie, car je n’ai pas su comme lui, mener une carrière et gagner suffisamment d’argent pour devenir quelqu’un. Ma mère n’est pas loin de penser la même chose, mais elle sait au fond d’elle qu’il y a en moi quelque chose qui est en germe. Elle a vu l’éclat que lui n’a pas su voir. Pour lui, seuls les résultats comptent. Mais ma mère sait que je ne suis pas un garçon comme les autres, puisqu’elle m’a fait. Je fais partie de ces êtres qui nécessitent plus de temps et d’attention avant de déployer leurs ailes. Même si j’ai su prouver depuis longtemps ma capacité à être autonome, je n’ai pas encore exprimé, ici bas, tout ce dont je suis capable. Je ne suis ni moins bien ni meilleur que les autres. Je suis différent, simplement parce que je ne suis pas conforme à l’idée que la majorité ce fait de ce qu’elle doit être. J’ai quarante cinq ans, un doctorat d’histoire en poche qui ne me sert pas à grand chose, puisqu’en tant que photographe, j’exerce un métier ingrat, sans talent particulier, et que pour m’en consoler, je n’ai pas même été fichu d’avoir une femme et des enfants. Et, pour couronner le tout, je m’apprête à larguer les amarres pour courir le monde… J’avoue que si j’étais à la place de mes parents, moi aussi j’aurai eu le droit de me poser certaines questions. Mais je suis ce que je suis, parce que j’ai choisi la vie que je mène, dans chacun de mes choix. D’une graine de baobab ne peut surgir un chêne, pas plus que d’un bouton de rose ne peut éclore un trèfle à quatre feuilles. J’ai choisi la liberté plutôt que la sécurité, et ce, délibérément. Telle est ma faute !
Ma mère est là, qui regarde son fils partir. Et je la regarde qui me regarde m’éloigner. Cette mise en abîme suscite en moi un léger vertige, c’est donc vrai que je m’en vais ? Je quitte cette île où je suis né, je laisse mes parents, mes amis, j’abandonne cette vie d’avant, je me défais de moi-même, de cette chrysalide qui m’étouffait. Mon départ pour l’Afrique du Sud ne fait que réparer une entorse au cours des choses. J’aurai dû fuir depuis longtemps.
Ma mère est là, cette femme admirable, qui m’a porté, puis donné vie, et qui maintenant me voit se détacher d’elle comme un fruit tombant de l’arbre. Nous savons bien tous les deux qu’il est temps que j’entame ma vie, que je la fasse complètement mienne. Je n’ai plus à lutter pour préserver un semblant d’existence familiale. J’étais revenu chez mes parents par fidélité, pour empêcher que les murs ne s’effondre, alors qu’ils étaient déjà lézardés de toute part. Si je n’avais pas pris ma décision, et surtout, si je ne l’avais pas mise en oeuvre, j’aurai été enseveli par une obéissance idiote. Qu’on fait mes ancêtres, sinon fuir leurs misérables existence en quête d’une vie meilleure ? Je porte en moi l’appel du voyage, comme un atavisme. Je dois moi aussi traverser les eaux noires, pour aller encore plus loin. J’en ai eu l’intuition enfant. Je savais que ma vie ne pouvait, ni devait, se liquéfier sur place. Il y a tant de choses à voir, tant à découvrir. Tous ces êtres, qui, ailleurs, ont tant de secrets à m’enseigner, comment pourrai-je les respecter si je ne venais m’incliner vers eux ?
Je passe le portique de sécurité, comme un acteur quittant la scène. Mes parents sont de l’autre côté, ensemble, dans une solitude dont ils ne peuvent se consoler l’un l’autre. J’ai franchi le seuil de non-retour. Je ne les vois plus. Je suis seul, face à moi-même. La salle d’attente n’est pas encore assaillie de ces cohortes d’oiseaux migrateurs, qui vont et viennent d’un hémisphère à l’autre.
Je ne tarde pas à embarquer… Direction l’Ile Maurice, où après une brève escale je changerai d’appareil pour Le Cap. Notre monde a bien changé en quelques décennies. Combien de fois mon père m’a-t-il raconté son voyage en Super Starliner, lorsqu’il était partit travailler à Paris à l’aube de ses vingt ans ? A cette époque, les avions cabotaient encore d’une escale à l’autre, alors qu’il suffit de moins de 24 heures de nos jours, pour rejoindre n’importe quel point du globe. Déjà, en 1939, dans Terre des hommes, Saint-Exupéry, décrivait les profonds changements qu’il constatait à son époque : « Notre psychologie elle-même a été bouleversée dans ses bases les plus intimes. Les notions de séparation, d’absence, de distance, de retour, si les mots sont demeurés les mêmes, ne contiennent plus les mêmes réalités ». Depuis, ce mouvement n’a cessé de s’amplifier. Aujourd’hui, où que nous soyons, sans même avoir besoin de sortir de chez soi, nous sommes reliés instantanément les uns aux autres. Une myriade de satellites lancés dans une course effrénée autour de la Terre relayent nos conversations téléphoniques et nos échanges informatiques à la vitesse de la lumière. Scrutant la surface du globe dans ses moindres recoins et épiant nos déplacements avec une précision de carte d’état-major, cette armada technologique a pris au piège la planète, comme se retrouve prisonnier du désir le buste d’une femme comprimé dans son corset.
Aux progrès des transports et des communications, s’ajoutent d’autres modifications tout aussi radicales. En moins d’un siècle, les langues les plus étranges et les plus anciennes ont disparu par centaines au profit de celles, peu nombreuses, qui ont cimenté les empires défaits, mais qu’emploient encore des milliards d’individus, qui semblent se comprendre en habitant, pourtant, des mondes aussi éloignés que ne le sont les galaxies entre elles. La mondialisation des échanges commerciaux a modelé le catalogue de nos désirs en favorisant la standardisation de nos besoins, de nos goûts et de nos centres d’intérêts. Les frontières sont-elles devenues plus perméables et les distances raccourcies pour que nous puissions, en toute saison, nous approvisionner en fruits ou en légumes, mais aussi en objets manufacturés de toutes sortes ? L’Homme moderne est un consommateur insouciant des pesanteurs du réel. Pour lui, la modernité ressemble à un jardin d’Eden, où le bonheur consiste à cueillir les fruits les plus inutiles de ses envies en poussant son caddie dans les allées des supermarchés bondés.
Dans les limbes de ce paradis, les ethnies les plus esseulées se replient au creux des forêts que massacrent les tronçonneuses et les engins de terrassement. Des routes s’enracinent là, où jadis, aucune civilisation n’avait triomphé de la jungle. Partout, le progrès s’installe, terrassant ces hommes armés de lances et de flèches, qui n’ont pas vu passer le temps, et pour qui, maintenant le temps est compté. Au milieu des déserts, plantées comme des bouquets de fleurs artificielles et vénéneuses, des villes futuristes s’érigent en point de mire, plus crânement que la tour de Babel. Partout, l’écorce terrestre se fissure de routes encombrées de voitures ou de camions ; de lignes ferroviaires labourant les plaines inondées de banlieues, de friches urbaine et de campagnes abandonnées… Au large des continents, des cargos indolents comme des fétus de pailles drainent leurs containers de marchandises, ballotés au milieu des océans, tandis que des chalutiers raclent les fonds marins en trainant leur nasse comme un voile de mariée. A 10 000 mètres d’altitudes, filant d’une mégapole à l’autre, des avions dessinent à la craie blanche des lignes éphémères sur un tableau délavé par la course des vents. Ces caravelles à la carlingue d’acier écument les cieux, comme autrefois les navires en partance sillonnaient les océans les cales remplies d’or, de poivre ou d’esclaves.
Pour les voyageurs comme moi, qui aiment rêvasser le nez collé au hublot, il n’est pas de spectacle plus émouvant que celui de ces longs trajets au milieu des nuages, où l’on aperçoit, lorsqu’il fait nuit, les étoiles et la lune se mélangeant aux lueurs des villes, ou, en plein jour, des terres et des mers baignés d’une douce lumière aveuglante, lorsque le soleil exulte encore. Il est encore tôt, ce matin, lorsque je m’envole vers Cape Town. Comme l’avait compris Saint-Exupéry, ce vieux renard des airs, « L’avion est une machine sans doute, mais quel instrument d’analyse ! Cet instrument nous a fait découvrir le vrai visage de la terre ». Les descriptions poétiques de ces terres exotiques, de ces montagnes aux versants abrupts ou de ces déserts enflammés, qu’il a effleuré dans le tangage de son cockpit, font partie de ces pages enivrantes, qui donnent à la littérature toute sa noblesse.
Jamais, je ne saurai décrire des paysages avec des mots, puisque toute description quelle qu’elle soit m’est difficile à réaliser. C’est sans doute, pour cela que je suis devenu photographe, pour satisfaire une paresse naturelle, où la chose à montrer parle pour elle-même.
L’avion commence sa descente avec souplesse. J’aperçois ce morne qui se dresse comme la pointe d’une citadelle escarpée. Le sable blanc et l’eau turquoise des plages s’apprivoisent dans le froissement des vagues, dont l’écume forme un ourlet évanescent autour du rivage. Virant dans les terres, l’appareil croise une forêt d’émeraudes. Des conifères sages et patients nous regardent passer en rêvant de nuages chargés d’eau. Puis viennent les champs de cannes, délimités sobrement par ces chemins qui ont gardé en mémoire la trajectoire de ces hommes mangés par l’histoire.
Soumeya a déjà pris son poste à la Commission de l’océan Indien, à Quatre Borne, je crois. Elle est partie depuis quelques semaines déjà. La dernière fois que je l’ai vue, je lui avais offert un exemplaire du Loup des Steppes, de Hermann Hesse. A l’intérieur, au crayon de papier, d’une écriture fine j’avais écris cette dédicace :
« A travers ce livre, tu découvriras combien la complexité de l’âme humaine est sans fin, car la tension tragique qui s’exerce en nous, pour que nous devenions humains, est souvent d’une violence inouïe. Seule la culture - une culture ouverte et éclairée - peut nous sauver des ténèbres sauvages qui sommeillent en chacun de nous, car elle nous force à rompre avec nos certitudes, pour mieux découvrir dans l’altérité, ces reflets infinis de nous mêmes.
J’ai été heureux de contempler la pureté de ton âme et d’y déceler les richesses de ta pensée. Puisses-tu devenir une voix forte et éclairée, capable d’inspirer et de guider les esprits pour construire un monde de tolérance et de paix ».
Soumeya est une belle âme, encore jeune et fragile, et pourtant, déjà si forte. Lorsque nous revenions de nos semaines de formation, nous faisions la route ensemble et dans la voiture nos conversations étaient toujours des plus stimulantes. Hébergés au Tampon, nous formions une équipe d’une douzaine d’apôtres, appelés à répandre avec ferveur les bienfaits de notre mission de coopération régionale dans la zone océan Indien. Willy, David, Isabelle, Fanny, Teffy, Luv et Elodie avaient été affectés à Madagascar. Mirella aux Seychelles. Thomas, à Port-Elisabeth, en Afrique du Sud, et Valériane et moi, à Cape Town. Thomas s’envolera après moi et chacun de nous sera à sa place. Un point sur une carte. Le temps que fleurissent les flamboyants. Une année, ou presque, à l’étranger et la possibilité de renouveler le contrat pour une nouvelle floraison. Pour moi, le départ à quelque chose de plus définitif. Je ne reviendrais en décembre, lorsque les Flamboyant auront revêtus leurs couronnes de sang, que pour refaire mon visa et régler quelques détails pratiques avant de m’envoler à nouveau.
Le rugissement de l’avion retentit avec force. Le voilà qui défie les lois de l’apesanteur pour s’arracher au sol. Notre course a repris de plus belle. Je me rapproche de mon but, de cette terre sud-africaine dont j’ai tant rêvé. Ce voyage me projette vers une vie nouvelle, que j’ai choisie de vivre sans concession. Il n’y a rien à regretter, rien à redouter. Je vole vers l’horizon que j’ai choisi d’accoster, pour y vivre ma vie, quittant celle à laquelle j’ai refusé de me plier. Il n’y a ni lâcheté ni courage à suivre sa volonté. Je sais bien, malheureusement, que tous les hommes ne sont pas libres et égaux en droit. Mais, puisque je suis libre, devrais-je renoncer à ma liberté ? Non, je ne le puis ! J’entends jouir pleinement de cette liberté. Sinon, à quoi bon ? Je ne peux fouler aux pieds le sacrifice de ceux qui sont morts pour que d’autres jouissent de cette liberté à laquelle ils aspiraient. Je ne revendique pas ma liberté comme un dû, mais comme un devoir de mémoire et d’accomplissement. Je ne veux pas être libre pour échapper à mes devoirs. Je veux être libre de donner du sens à ma liberté, et donc à la vie qui est la mienne.
Par le hublot, j’aperçois la silhouette de mon île natale, qui se dessine comme une oasis dans un désert de vagues et d’embruns. Les terres brûlées du Piton de la Fournaise, parsemées de fumeroles, semblent si douces vue d’en haut. Je me souviens d’avoir survolé le cratère en feu, à bord d’un ULM, lors d’une éruption récente. Des jaillissements de lave projetaient un torrent qui se déversait du chaudron comme une soupe épaisse, visqueuse mais chatoyante. Pris de fascination pour ce réveil majestueux des forces ténébreuses de l’île, Stan, Ketty et moi, nous avions affronté la nuit glaciale et ses bourrasques, pour cheminer dans l’obscurité de la nuit, du Pas de Belcombe jusqu’au Piton Partage, où s’étendait l’enclos et sa chimère crachant ses gerbes de feu. Le souffle du monstre, haletant, concentré sur sa création, parvenait jusqu’à nous, et nous étions comme enivrés de ses relents de souffre. L’île n’était donc pas achevée. Nous en avions la preuve. Travaillant aux forges, cognant son marteau contre l’enclume dans un vacarme assourdissant, Vulcain, produisait dans les entrailles de la Terre de la matière nouvelle, promise à enrichir les sols, longtemps après que la chaleur se soit évanouie et que les pluies aient baigné ce trésor pour le rendre docile, prêt à laisser croître ces forêts cachées dans leurs graines.
Toujours à bonne distance des côtes, je reconnaissais maintenant le Sud sauvage, et plus loin, les ramifications tentaculaires de Saint-Pierre, du Tampon et de Saint-Louis, qui dans une pression constante s’évertuaient à former un maillage étroit où les droits de la ville l’emportent sur ceux de la campagne. Puis, apparut le lagon. C’est là, je crois que j’ai vu Stéphanie pour la dernière fois. Au coeur de la nuit, nous avions drapé le monde de nos visions. Tout était à refaire. Mais il restait une constante : la beauté seule valait la peine que l’on y sacrifie tout le reste. Jamais, cependant, nous ne pourrions franchir ce pas supplémentaire. Elle restera énigmatique et silencieuse, comme une Joconde auréolée de vertu. Tous les malentendus naissent du langage, de la confusion que sèment dans nos esprits des mots que nous ne comprenons qu’à moitié et qui ne sont jamais les mêmes lorsqu’on y repense. De tous, le pire est « l’Amour », qui se confond avec « le Désir », car l’un ne peut naître sans l’autre, du moins, lorsque l’on ne cherche plus à combler la chair d’un manque. Le lagon s’éloigne, noyant derrière lui le souvenir de ce regard mystique, de ce sourire que je n’ai jamais pu embrasser.
Et puis, soudain, surgit une déchirure. L’île était fendue, comme d’un coup de hache. Une fissure large et profonde, s’enfonçant loin dans son mystère… Une figue offrant sa chair ouverte, voilà ce à quoi ressemblait l’île. Le vide central, cette absence décisive et nécessaire, pour que l’on y glisse une langue assoiffée d’une perle de pluie, d’une larme sucrée.
Saint-Gilles et les manguiers de mon père, Le Port, La Possession… L’île s’évanouissait. Je faisais route vers l’ailleurs, vers une promesse, un engagement vis-à-vis de moi-même que j’étais enfin en mesure de tenir. Presque vingt ans plus tôt, ma mère m’avait demandé d’accompagner ma soeur en Inde. Elle voulait y partir en voyage, avec ses deux enfants. Elysée, l’aîné avait quatre ans, et Rivka, trois mois à peine. A cette époque déjà, nos relations s’étaient tendues. Je n’avais pas envie de voyager avec ma soeur, et encore moins d’aller en Inde. Mais, je savais qu’elle partirait de toute façon. Aussi, fixais-je mes conditions. Je proposais l’Afrique du Sud. Je ne l’avais pas réalisé à l’époque, mais ce choix était logique. Plus jeune, j’étais parti seul, sac au dos, pour sillonner l’Afrique. Hélas, ce voyage fut écourté au moment où il devait réellement commencer. A Izmir, deux larrons que j’avais rencontré m’avaient convaincu de les accompagner en Libye plutôt que d'aller au Caire. Nous devions prendre le bateau le lendemain. Mais, lorsque j’ouvris les yeux, au matin, j'avais un mal de crâne terrible. Mes deux voleurs avaient pris la poudre d’escampette depuis longtemps déjà, me laissant en pyjama, seul, dans les rues froides, mais chaleureuses, d’Izmir. Cela s’était passé cinq ans plus tôt, avant que ma soeur se ne décide à m’accompagner en Afrique du Sud, avec ses deux enfants. Cela ne changeait pas grand chose pour elle, puisqu’elle avait besoin de prendre le large, d’une façon ou d’une autre. Pour moi, ce changement de perspective était d’une importance capitale. En restant maître d’aller là où bon me semble, et non là où l’on me disais d’aller, j’assumais ma liberté, ma volonté, mon désir inconscient de renouer avec ce voyage inachevé.
Lorsque le hublot se remplit de cette terre rouge, je savais que nous survolions la Grande île. Madagascar. Je m’étais assoupi. Nous avions déjà traversé la moitié de l’île. Je scrutais cette terre étrange, emprunt de magie, mais qui vue d’en haut ne semblait plus qu’un corps gratté jusqu’au sang, une plaie pulvérulente. Mon ami Willy avait tenté l’aventure avec sa femme et sa fille. Ils étaient partis tous les trois. Nous nous étions dit au revoir longuement, et là, en survolant cette terre où ils s’étaient installés, je savais que dans quelques heures, je serai moi aussi, livré à ma responsabilité, acculé à la réalité de mes choix et de leurs conséquences. Un fleuve brunâtre vomissait sa diarrhée, loin des côtes malgaches. Ce pays était décidément mal en point.
Quelques navires tentèrent de nous accompagner, mais ils flairaient le poisson et se remirent bien vite à cueillir les fruits amers d’une pêche misérable.
L’avion se remit à bourdonner lentement. A l’horizon, rien d’autre que des royaumes de nuages perdus dans la solitude des océans, à perte de vue.
Après quelques heures de vol, où je m’étais laissé allé à un profond sommeil, j’ouvrais les yeux. La terre en bas ne ressemblait plus à aucune île. Nous avions abordé l’Afrique, ce continent tragique, situé au centre du monde, mais relégué à la périphérie de toute évolution historique, selon certains. Nous suivions le courant d’Agulhas, traversant le Kwazulu Natal ou le Eastern Cape. Un vieil Anglais, se penchant vers moi pour observer le paysage avec gourmandise, engageât la conversation. Sans doute un homme d’affaire ayant pris sa retraite. Quelqu’un de cultivé, d’intelligent et ouvert d’esprit, connaissant bien l’Afrique du Sud, puisqu'il y retourne tous les ans, pour rendre visite à son beau-frère. Mes premiers mots en anglais… Mes premières bafouilles. Et pourtant, comme toujours, nous nous comprenions…
Une montagne noire, figée dans son éternité minérale, s’effilochait en dessous de nous. L’on distinguaient, ça et là, quelques villes perdues. Nous survolions le Western Cape depuis un moment, approchant lentement de notre destination. Quarante-cinq minutes plus tard, l’avion effectua un virage et commença sa descente. L’ombre de l’Airbus 319 courait le long d’un township. Un alignement de maisons scrofuleuses, des blocs d’habitation délabrées, les prisons de la pauvreté. Des rues dévastées, couvertes de cratères, de carcasses de voitures. En dessous un paysage de guerre, de lutte, de résistance… Une bataille sans fin contre le dénuement. Une lutte de tous les instants pour survivre et qu’importe la dignité si l’on peut grappiller quelques restes. Même les lignées de maisons flambant neuves avaient encore l’air de baraquements pour criminels. La géographie ne ment pas. Les quartiers ont leurs propres logiques, leurs règles de grammaires pour conjuguer, selon les modes, la misère ou l’aisance. Des lignes invisibles divisent, séparent, cloisonnent, tiennent à distance, protègent, emmurent, illusionnent. A mesure que nous touchions au but, la pauvreté s’évanouissait, comme si jamais elle n’avait existé, cédant la place aux maisons avec piscine et jardin. Là, des hommes qui vivent comme des bêtes ; ici, ceux qui se croient libres. Et pourtant, les uns et les autres ne peuvent vivre les uns sans les autres. Ubuntu !
L’avion s’est posé. Il vient d'épouser la terre, pour nous ramener à la réalité des hommes.
Pressé par les autres voyageurs, qui veulent s'enfuir au plus vite vers leur destin, je sors de cette chrysalide de métal et dont les portes se sont enfin ouvertes ; le temps de l'éclosion est venu. Je récupère mes bagages et cette légion de clandestins, qui ont voyagé à fond de cale : Maalouf, Watzlawick, Levi-Strauss et tous les autres. J'attends dehors, mais je ne vois pas le Directeur de l’Alliance. Suis en avance ou en retard ? Je reviens sur mes pas. je l'aperçois enfin. Christian Pizafy me cherche aux milieux des passagers qui sortent encore. Je m’approche et je lui demande en plaisantant s’il attend quelqu’un. Son visage s’illumine, il me tend une franche poignée de main. Ca y est, tout commence. Je l’apprécie déjà. Il est venu m’accueillir avec sa femme. Ils m’invitent à manger. Nous nous installons dans un restaurant où l’on sert, paraît-il, d’excellents fruits de mer. La serveuse, un peu malhabile, nous apporte de grandes casseroles des poêlées de crevettes, de moules et de calamars. Je me délecte. Christian respire la vie, l’énergie, un appétit insatiable de rencontre et de discussion. Pour cet homme là, je suis prêt à travailler, à soulever des montagnes, puisqu’il a une force de conviction sans pareil.
Le repas fini, nous nous installons dans sa voiture, et nous voilà sur la route. Nous effleurons les ghettos et leurs faces présentables… Ces alignements de bâtisses neuves, qu’un souffle suffirait à ébranler. Des clôtures de chaque côté de la route, pour marquer les territoires. Interdit de s’arrêter, sous quelques prétextes que se soit. Il faut rouler droit, filer devant soi, ne pas regarder par les fenêtres…
La ville se dessine, les montagnes aussi. D’abord, ces arbres, ces pins, qui s’élancent outrageusement, pour attraper le soleil. Puis, le port et la voie ferrée… Les immeubles… Les rues… Nous sommes dimanche. Cette ville est déserte. Où sont les hommes ?
Nous passons devant l’Alliance, le berceau de ma nouvelle vie. Puis, Christian me dépose, un peu plus loin au 91 Loop Street, c’est un backpackers où j’ai réservé une chambre…
Je suis surpris par son air enjoué, qui tranche avec l’attitude glaciale qu’elle avait adoptée la dernière fois que nous nous étions vus, avant le départ. C’était dans l’hémicycle du Conseil départemental, où nous étions appelés à témoigner devant un parterre de candidats potentiels aux prochaines migrations. Nous faisions figures de sages, d’élèves modèles rencontrant les petits nouveaux, qui allaient s’évertuer à suivre notre exemple. Depuis notre formation, au Tampon, Valériane s’était montrée réticente, froide, hostile parfois vis-à-vis de moi. Mais elle avait aussi essayé de se montrer plus agréable, sans que jamais nous n’ayons pu réellement sympathiser. Ce traitement de faveur m’était réservé. Je n’ai jamais vraiment compris pourquoi et je dois avouer que cela m’a profondément perturbé avant le départ. Devrais-je l’affronter à Cape Town, comme l’on affronte une ennemie, alors même que nous étions sensés travailler de concert ? Ce n’est pas vraiment ce que j’espérais. L’un de nos formateurs, un être formidable, dont j’ai appris plus tard qu’il était décédé peu de temps après notre formation, nous avait sensibilisé à la résolution des conflits. Il travaillait beaucoup avec les jeunes en difficulté et nous faisait part de son expérience avec une grande sagacité. Lorsqu’il nous expliqua un jour, que les conflits n’étaient le plus souvent que l’expression de tourments inconscients, qui poussaient au moins l'un des belligérants, à projeter sur l'autre, sans raison apparentes, toute l'acrimonie dont il pouvait faire preuve, je compris que la réalité du conflit créé par Valériane relevait de quelque chose qui m’échappait, mais dont je n’étais pas responsable, du moins, pas consciemment. La chose n’était pas passée inaperçue. Thomas, Someya, Willy et même Mirella étaient surpris qu’elle puisse se comporter aussi sèchement. Un jour où elle se montra particulièrement exécrable, elle m’appela ensuite sur mon téléphone, pour me demander si nous pouvions discuter chez elle. La discussion s’engagea sur la terrasse de la petite maison qu’elle occupait provisoirement. Elle me présenta d’emblée ses excuses, que j’acceptais aussitôt. Pensant que le moment était propice, j’en profitais pour mettre à plat quelques remarques qui se voulaient constructives, pour que nous n’ayons plus à résoudre ce genre de situation dans l’avenir. Mais, alors que je n’y attendais pas, Valériane soudain me demanda d’une voix faussement ingénue, si j’avais l’intention, du haut de mes quarante cinq ans de lui apprendre, à elle, une jeune-fille d’une vingtaine d’année, ce qu’est la vie ? Elle avait réussit en une seconde à détourner l’ensemble de mes propos pour en faire un acte d’accusation. Je me levais d’un bond, sans dissimuler ma colère, et je lui dis que cette conversation n’avait plus lieu d’être. Je m’apprêtais à partir, mais surprise par ma réaction, elle se radouci et m’invita à me calmer. Puisque nous ne pourrions espérer devenir les meilleurs amis du monde, nous décidâmes d’adopter une attitude professionnelle, où la communication se limiterait à sa stricte nécessité. La retrouver, ici, dans le même backpackers que moi était bien la dernière chose que j’aurai pu imaginer. Mais après tout, peut-être que notre dépaysement mutuel nous offrirait l’occasion de ne plus percevoir en l’autre une menace, mais une chance à apprivoiser.
Le réceptionniste me fit signe d’avancer. Valériane s’éclipsa. Je remplis les formalités, mais, au moment de payer, ma carte bleue ne semblait pas vouloir fonctionner. Allais-je me retrouver à la rue et sans moyen de paiement, dès mon arrivée ? Une certaine angoisse me traversa l’esprit, mais je restais calme. Qu’est-ce qui n’allait pas avec ce code ? Finalement, le manager intervint et procéda au paiement sans que je n’ai besoin de valider ce satané code. J’étais sauvé ! J’allais enfin pouvoir me reposer.
Je compris quelques jours plus tard que j’avais utilisé le code de ma précédente carte. Je fus soulagé d’avoir retrouvé la mémoire et mon pouvoir d’achat, qui faisaient de moi à nouveau un homme libre !
Still Water
Pourquoi aimons-nous ce que nous aimons ?
J'aime l'Afrique du Sud et cela depuis ma première visite en 1998. Mais en venant ici, je n’espère pas refaire le même voyage. A quoi bon ? Tout change si vite dans la vie : tous ceux qui vivent à nos côtés prennent des rides et deviennent différents par lassitude, les paysages que nous traversons tous les jours se transforment à notre insu, les pays que nous avons sillonné se sont métamorphosés et notre mémoire, elle aussi, nous joue des tours. Et puis, surtout, nous aussi nous changeons. Nous vieillissons autant que ceux que nous voyons prendre de l'âge, en oubliant que le temps s'acharne aussi à nous rendre différents de ce que nous fûmes, lorsque dans la fleur de l'âge, nous étions jeunes et beaux, promis à l'insouciante éternité des gens heureux.
Alors, comment aimer ce que nous aimons, puisque ce que nous aimons n'est plus fidèle depuis longtemps à l'image que nous en avions ? Tout s’étiole sans que nous n'ayons conscience du changement. L'illusion rassurante de la continuité est un tranquillisant pour les âmes sensibles.
Cette Afrique du Sud que je retrouve aujourd'hui ne peut plus être celle que j'ai connue, puisqu'elle a changé et moi aussi. Je le sais, et je ne m'en désole pas. Je n’ai aucune raison d’être désabusé. Ma joie est entière. Et s'il y a bien une seule chose qui ne peut me tromper, c'est que le goût de l'eau ici, est toujours le même. Ce goût limpide et pur de l'eau minérale. Cette eau n'a aucun arrière-goût. Dès la première gorgée, elle vous paraît si familière que vous savez au fond de votre âme qu'elle vous est restée fidèle. Vos artères n'ont certes plus la même vigueur, mais elle est toujours aussi bonne, aussi désaltérante, aussi douce et poétique, qu'il faut l'embrasser, à pleine bouche, en la remerciant de ne s’être pas mélangée à d'affreux colorants.
L'eau pure et cristalline du Cap vaut mieux que tout les cépages du monde, parce qu'elle seule a gardé ce goût de l'aube primitive. Et Dieu sait que le vin est délicieux ici !
Des millions d'années sont nécessaires à ce que le cycle s'achève et recommence sans cesse. Des montagnes à la mer, de la mer aux nuages, des nuages aux montages. Ce sont toujours les mêmes molécules qui s'assemblent et se reforment dans une variation infinie de combinaisons.
Ici, à Cape Town, le niveau d'alerte sur le manque d'eau est au niveau 3, sur les 5 que comporte cette échelle préventive. Sur les murs des salles de bains, du 91 Loop Street, on peut lire les consignes : "buvez plus de bières et moins d'eau". Moi, je n'aime pas la bière. La permanence de la permanence n'est plus une garantie d'avenir. Ce qui a toujours été ne sera sans doute plus.
L'eau de Cape Town n'est rien sans la lumière et sans la terre. Ici, les arbres croissent comme des coups de pinceaux sur une toile de maître, légèrement penchés par la force des vents, démesurément grands, à la mesure du continent.
La lumière s'étale sur la terre et sur les montagnes, comme une couche de peinture jaunâtre, légèrement diluée par le temps. Et le ciel se contente d'entourer la terre et la mer. L'air marin souffle gentiment dans les ailes des oiseaux, les poussant plus haut encore. L'azur de la ligne d'horizon, où se perd la silhouette des montagnes les plus éloignées, me rappelle les couleurs de la Baie des Anges.
J'ai marché de longues heures, à contourner cette montagne arasée en forme de table, où quelques dieux africains avaient dû jeter autrefois une nappe pour un festin mémorable. J'allais en suivant les marées où longtemps se sont échoués des navires aux cales gonflées de marchandises et d'épices. Combien d'hommes ont perdu la vie sur ces rivages trompeurs à cause d'une mauvaise tempête ?
Sur le Waterfront, là, où, les badauds se trainent, achètent et consomment plus qu'ils n'en ont besoin, des bateleurs animent la foule paresseuse mais prête à s’émouvoir. Un jeune asiatique, à la souplesse d'un moine shaoline, beau comme une divinité incarnée, marche sur du verre, avale des sabres en plastique et surtout défie les lois de la gravité en faisant danser une boule de verre, puis une autre tout au long de ses bras et de sa nuque. Plus loin, s’immobilise longuement un homme automate, que seul son regard espiègle trahi lorsqu'il se moque à sa façon de son public en capturant une main innocente venue lui glisser une pièce dans son chapeau.
[description à venir de ma prise de poste et des premiers jours de travail].
La mauvaise rue
Aujourd'hui, est un autre jour. Après mes heures de service, d'une journée bien remplie, je suis allé à un rendez-vous, sur Constitution Street. Je devais visiter un appartement. Déconvenue. Quartier sale et triste, inquiétant, même si le sourire de Mandela illumine la façade peinte d'une maisonnette abandonnée. La propriétaire ne vient pas. Elle a du retard. Au moment où je m'en vais, elle arrive. Je visite sa demeure. Insalubre dans une résidence sécurisée. Je m'en vais. Même si ma recherche n'a pas aboutie, au moins, j'ai vu cette autre réalité, celle que l'on aime pas voir d'habitude.
L'ombre de la nuit enveloppe Cape Town et ses alentours. Il ne faut pas que je traine. Le quartier est vraiment pourri. Suivre la direction de Signal Hill, c'est là que se trouve Loop Street. Je décide de couper au plus court. Mais suivre la bonne direction n'indique en rien que l'on atteindra la bonne destination. Je remonte la rue longeant le Parlement. Impossible de tourner à droite, pour rejoindre Long Street et donc Loop Street, qui est parallèle. Je poursuis. Et lorsque enfin j'aperçois une petite rue, qui étrangement s'appelle « Avenue street », tournant dans la bonne direction, je m'y engouffre pensant être sauvé. Cette seule pensée m'avait déjà condamné, car dès que l'on cède à la peur, les fauves tapis dans jungle sentent à dix mille lieues la chair épouvantée. Face à moi s'avance un couple. Pas de danger à priori, mais mon intuition me dit d'éviter d’avancer au milieu de ce couple qui se divise comme un fleuve pour mieux me prendre à son filet. J'esquive en me déportant sur ma droite, mais il est déjà trop tard. J'ai compris que le couple est en chasse et que je suis la proie dans cette avenue qui n'a rien d'une avenue, à part quelques arbres poussifs qui dorment depuis longtemps. Je suis seul, mais lorsqu'on est seul avec soi-même, on est toujours deux. Tout va très vite. Le fauve bondit sur moi, tandis que la lionne s’avance quelque part dans mon dos, il cherche à m'agripper, je m'échappe, il sort son couteau, qu'il ouvre lentement, mais ses yeux sont assoiffé du sang qu'il sent battre en moi et dont il veut se repaître. Tuer, pour lui, ce n'est qu'une vieille habitude, une seconde nature dont le regard glacial ne laisse aucune équivoque. Il veut m'imposer sa brutalité, parce que la bête sauvage qui est en lui ne connaît plus la douleur, ni la soif, ni la faim. Cela change de ces demandes polies de sans abris, qui vous remercient de les avoir écouté, même quand vous n'avez n'avez rien à leur donner. Mais lui, la bête, il ne demande rien, il s'octroie, il prélève son dû, comme autrefois ces bandits de grands chemins réclamant "la bourse ou la vie". Il me demande : est-ce que tu veux mourir ? Ce qu'il ne sait pas, c'est que ma peur n'est pas celle que l'on ressent lorsque l'on est face au frisson du dernier instant. Non, je n'ai pas peur de mourir, même si évidemment, j'ai peur d'avoir mal, d'être là, agonisant, alors que tout commence à peine et que je me sens enfin vivant ici. Non, je n'ai pas peur de la mort. J'ai eu peur de ne pas pouvoir vivre assez longtemps pour finir ce que j'ai à faire. Je refuse de mourir sans mon consentement. Je veux écrire mes livres, voir ces peuples dispersés qui malgré tout ce qui les opposent tissent notre humanité commune, je veux rencontrer cette femme qui me cherche quelque part, peut-être lui faire quelques enfants, et aussi, transmettre ma foi en l'humanisme, œuvrer d'une façon ou d'une autre, et à la mesure de mes forces, pour que ce monde soit un peu plus lumineux qu'il ne l'est aujourd'hui.
J'ai de bonnes raisons de vivre. Je l'ai toujours su, et sans doute aujourd'hui plus que jamais. Je n'ai pas le droit de mourir sans avoir achevé ma quête, et donc, sans avoir donné à ma vie, le sens que je lui donne. Je ne veux pas œuvrer pour une quelconque postérité. Je travaille pour moi, je suis l'artisan et le salarié de ma propre vie. Je suis en accord avec ma philosophie, avec mon regard sur le monde.
La pointe de son couteau contre ma vie ? Non merci. Ma vie est plus précieuse qu'une simple intimidation. Puisque j'étais seul avec moi-même, mon moi, m'a dit sagement, que te veux cet imbécile dont tu n'as déjà jouis ? Même s'il te prend ta vie, ta vie a déjà été meilleure que la sienne. Que peut-il vouloir ? Du respect, de l'attention ? Non, pas lui, il est trop mesquin pour cela, trop carnivore. Il lui faut de l'or. Encore et toujours de l'or. Accepte de perdre un peu, et tu sauveras tout le reste, l'essentiel. Je lui ai donné mon téléphone portable. Oui, je le lui ai donné, avant qu'il ne me le prenne. Pour lui, il n'y a pas de différence, puisqu'il a obtenu ce qu'il désirait. Pour moi, cela change tout. Il n'a rien pris que je n'ai voulu librement lui offrir. Ma vie contre un téléphone. Oui, certains bonheur n’ont pas de prix !
Dans la bousculade qui a précédé le don, j'ai senti mes jambes défaillir. J'avais trop marché et soudain, mes muscles se sont froissés. Tant pis ! Qu'importe cette douleur, j'ai sauvé ma peau.
N'être si peu de chose avant de naître, et n'être plus rien, après la vie, voilà donc le secret des Hommes.
Isidore et Donnie
En m'engageant dans Avenue Street, je n'avais qu'une idée en tête, rentrer chez moi au plus vite pour remettre en lieu sûr les 6000 Rands que j'avais dans la poche arrière de mon pantalon. Pourquoi se balader avec une telle somme alors que l'insécurité en Afrique du Sud est une des caractéristiques du pays ? Christian m'avait expliqué qu'ici, lorsqu'on visite un appartement et que l'on veut le retenir, il faut mettre des billets sur la table. Évidemment, il faut signer un contrat avec le propriétaire, mais cela permet d'éviter que l'appartement ne vous passe sous le nez, parce que quelqu'un d'autre a fait ce qu'il fallait et pas vous. Avant de partir, j'avais demandé à mes collègues ce qu'ils pensaient du quartier où se situait Constitution Street. Valérie m'avait dit de faire attention, car la gare qui était à proximité drainait des zonards peu recommandables. Mais Patricia, qui y avait habité, pensait au contraire que c'était un chouette endroit. Mais ici, tout est affaire de nuances. Constitution fait partie de ces endroits dont le nom correspond à deux réalités que seule sépare une ligne de démarcation invisible sur une carte. Quartier Blanc / Quartier Noir. Une seule Constitution pour un même peuple, mais en réalité, deux peuples distincts, qui se côtoient sans se mélanger.
J'étais prévenu et je m'attendais au pire. Le seul moyen de trancher l'affaire était d'aller voir par moi-même. En passant cette ligne invisible, je me suis bien rendu compte que ce n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. J'aurai dû partir plus tôt, au lieu d'attendre la propriétaire qui m'a joué un sale tour en me faisant attendre plus de quarante cinq minutes pour finalement m'annoncer que l'appartement était loué.
En remontant la rue qui longe le Parlement sud-africain, je sentais cette atmosphère étrange qui règne ici, et que j'avais déjà perçue à Durban, lors de mon premier voyage. Les vivants rentrent à toute allure se terrer dans leurs foyers protecteurs, tandis qu'une faune patibulaire se réveille à la tombée du jour. Je marchais à vive allure, avec l’assurance d’un skieur slalomant entre les obstacles. Puis, en passant près de ce restaurant très chic, où plusieurs personnes prenaient un verre, alors qu’un peu plus loins de jeunes cadres blancs discutaient dans la rue, je sentais que je sortais de la zone de turbulence. Aussi, en m'engageant dans Avenue Street, je savais que Long Street n’était plus qu’à quelques encablures. Je l'ai d'ailleurs vérifié le lendemain, en refaisant un bout du chemin, avec ma collègue Valériane. Le plus navrant, c'est que le Consulat de France n’était qu’à deux pas de là.
Après avoir cédé mon portable, j'ai rebroussé chemin, espérant retrouver les jeunes cadres qui discutaient à l'angle de la rue. Mais un individu malfamé venait vers moi, j'ai cru qu'il s'agissait de mon joueur de couteau, j'ai donc tourné les talons. Je me suis approché d'un de ces hommes qui gardent les rues, vêtus d'un de ces gilets jaunes fluorescents, très moches mais qui sauvent des vies sur les routes en pleine nuit. En m'approchant, je vis un visage buriné par les coups de la vie, un regard tout aussi glaçant que celui de mon apprenti tueur. Une hésitation. Puis-je demander de l'aide à cet homme ? En deux mots, je lui explique la situation. "Fucking bastard" jargonne-t-il à l'encontre de mon agresseur. Son accent est à coupé... au couteau ! J'ai cru d'abord qu'il parlait afrikaans. Un autre patrouilleur nous rejoint et nous voilà à la poursuite du chasseur. Tous deux ont des visages de repris de justice, de bagnards à qui la vie n'a rien épargné. Ils savent se battre à mains nues, recevoir des coups et les éviter. Mais ils ont choisi la voie de la rédemption, celle du service, du respect de l'ordre. Eux, ne sont pas des voyous, peut-être l'ont-ils été plus jeunes, mais à présent, leur dévouement est indiscutable. Ils ont choisi d'assurer la sécurité de ceux qui étalent leurs signes extérieurs de richesse, sans mesurer à quel point l'ostentation est le vecteur de la tentation. Sont-ils au service de la Justice ? Assurément, puisqu'ils m'ont protégé en me raccompagnant jusqu'à Long Street. Mais quelle justice servent-ils ? Celle qui pousse à la rue des hommes et des femmes, parfois des enfants, dénués de protection sociale ? Combien d'épaves, de vies abîmées, de laissés pour compte croupissent au bord d'une société qui exulte au soleil ?
La pauvreté est une réalité propre à l'espèce humaine. Les animaux n'ont pas besoin de richesses ou de trésors pour vivre heureux. Certes, les prédateurs sont omniprésents dans le monde animal. Mais le besoin de manger chez les animaux ne les poussent pas à jouir de la douleur qu'ils causent en prenant une vie, et, encore moins à vouloir dépouiller leurs victimes de leurs biens pour se croire un peu plus riche. Bien sûr, cette misère est répandue, depuis toujours, sur la Terre, comme une lèpre souterraine, qui engendre cette violence, que l'on redoute en voulant protéger ce que l'on possède, alors que les autres, la très grande majorité ne possède rien d'autre qu'un désir d'exister, tout aussi légitime. Au fond, notre folie n'est-elle pas d'accepter la folie du monde comme une chose ordinaire ?
Mes anges gardiens m'ont demandé si je pouvais reconnaître l'homme au couteau. Ils m'ont accompagné dans Compagny's gardens. Nous n'y avons vu que des damnés dormant sous des tentes dans le meilleur des cas, et à la belle étoile, lorsque l'infortune était à son comble. Ils voulaient l'attraper, le cogner dur, lui montrer à ce « bastard » que nul ne peut défier impunément l'ordre des riches. Ils voulaient lui faire la leçon, pour le corriger de ces errances et justifier ainsi leur maigre salaire.
Avant de nous séparer, le visage d'Isidore et de Donnie s'est éclairé à la lueur d'un lampadaire, lorsqu'ils ont prononcé leurs prénoms. J'ai vu alors dans leurs yeux, qu'il suffisait de peu de choses pour qu'ils puissent s’enorgueillir, eux aussi, d’être apparenté à la communauté humaine.
L’origine de la violence
« Aucune race n’est supérieure à une autre. Depuis la préhistoire, c’est toujours le rapport de force qui décide de qui est le maître et de qui est le sujet. Aujourd’hui, la force est de mon côté. Et même si je ne suis à tes yeux qu’un taré de nègre, c’est moi qui mène la danse. Aucun savoir, aucun rang social, aucune couleur de peau ne pèse devant une vulgaire pétoire. Tu te croyais sorti de la cuisse de Jupiter ? Je vais te prouver que tu n’es qu’un avorton comme nous tous, sorti d’un trou du cul. Tes titres universitaires comme ton arrogance de Blanc n’ont pas cours là où une simple balle suffit à confisquer l’ensemble des privilèges. Tu es né en Occident ? T’as de la chance. Maintenant, tu vas renaître en Afrique et tu vas comprendre ce que cela signifie ». Je viens de reposer sur la table le roman de Yasmina Khadra. L’équation africaine. Sur la couverture du livre de poche, le visage d’une femme africaine couverte d’un voile chamarré. A la manière de Mona Lisa, ses yeux ardent semblent me fixer d’un regard auquel je ne peux échapper. D’un geste de la main, elle recouvre sa bouche, comme pour taire son immense tristesse et celle de toutes les femmes du monde qui, comme elle, ne connaissent rien des plaisirs superflus qu’offre la modernité.
Demain, cela fera un mois que j’ai croisé le regard assassin de celui qui m’a initié à l’hospitalité africaine. J’ai failli mourir dans d’autres occasions, notamment dès les premiers jours de mon voyage en Asie du Sud-Est. A Bangkok, un autobus filant droit comme un missile a bien failli me réduire en bouillie. Mais, ici, à Cape Town, pour la première fois de ma vie j’ai croisé le regard d’un tueur. J’ai appris ma leçon et j’en suis heureux, car il n’y a que ceux à qui il n’arrive jamais rien qui n’ont rien à raconter. Ce soir encore, Christian et Patricia évoquaient, consternés, la mésaventure d’un photographe français, qui la veille de son retour, s’est aventuré seul dans un ghetto. Lorsque les agents du consulat l’on récupéré sur place, il était en slip, mais encore vivant, ce qui tenait presque du miracle pour une telle imprudence. Quelques semaines plus tôt, grâce à son sang froid, Paul, le fils de Patricia, avait échappé lui aussi, sans une égratignure, à une quinzaine de Noirs patibulaires, prêts à commettre l’irréparable en s’en prenant à lui et à l’une de ses amies, dans un parc de Johannesburg, où il vit depuis plusieurs années.
L’initiation est un rite de passage, un moment d’apprentissage où l’on se dépouille de son arrogance ou de sa naïveté pour faire preuve d’humilité, mais à condition ne point s’en lamenter. La victime clame son innocence, révulsée de l’injustice qui lui a été infligée. Mais moi, j’ai choisi d’assumer mes actes, j’ai choisi d’aller au bout de leur logique, sans pour autant provoquer ce qui m’est arrivé. C’est arrivé. Voilà tout ! Cela arrive tous les jours, partout ailleurs dans le monde, et je ne crois pas que l’Afrique soit un continent plus sauvage, plus brutal qu’un autre. C’est la nature humaine qui porte en elle cette infamie, cette soif du mal, surtout, quand la richesse se moque éperdument de la dignité de ceux qu’elle méprise. Poussés à bout, exclus du festin, ceux qui montrent les dents ont le même appétit que les convives, à ceci près que leurs ventres à eux restent désespérément vides. Suis-je en train d’absoudre cette racaille qui m’a pointé son aiguille sous le nez ? Non. Les choses sont ce qu’elles sont. Mais il nous faut apprendre à vivre avec elles. Chaque leçon de vie qui n’est pas apprise se répète inlassablement. Je ferai d’autres erreurs et j’apprendrais, sinon, à quoi bon vivre ?
J’ai compris aujourd’hui, que ceux qui tiennent les armes ne sont pas les plus forts. Tous les hommes ont peur. Certains ont peur de perdre la vie, d’autres de mourir et quelques uns redoutent, tout simplement, de vivre. Mais quelle différence réelle y a-t-il entre celui qui tient une arme et celui qui est visé ? L’un à le pouvoir de tuer l’autre, sans que la réciproque ne soit tout à fait vraie. Mais au-delà de cette apparence, qu’y a-t-il de réel ? Je crois qu’il n’y a pas de différence. Tous les hommes sont mortels, mais ceux qui pointent le canon de leurs armes sur des poitrines désarmées ont une peur plus grande de la mort. C’est pour tromper cette peur, qu’ils se parent de lames de couteaux ou de poudre et d’acier. Chaque poing brandissant une arme revendique une angoisse enfouie, qui se déchaîne, indomptable et outrancière. Cette démonstration de force n’est en réalité qu’un aveu de faiblesse. Celui qui tient une arme se protège de sa peur, celui qui n’en a pas doit affronter la sienne à mains nues. Parfois l’un deux s’effondre, mais l’apparente victoire du plus fort n’est qu’une illusion. La mort de l’autre est une réalité, certes. Mais le temps rétablira l’équilibre. A la fin, tous les hommes finissent en poussière.
C’est la vie ! Mais n’est-il pas étrange que la peur de la mort réveille en nous cette violence reptilienne ? Pour conjurer la fatalité de sa finitude, l’assassin se venge sur une proie dont il espère qu’elle ne lui donnera pas trop de fil à retordre. Ces gestes sont une inlassable répétition d’actes ancestraux, un infini perfectionnement de l’art d’ôter la vie d’autrui. Il y a mille façon d’anéantir ses semblables et l’homme est un tueur né. L’origine de la violence est, sans doute, aussi lointaine que la lignée des hominidés. C’est un héritage préhistorique, ancré dans nos gènes, qui hante notre mémoire collective de scènes de pillages, de viols, de meurtres, de massacres assourdissants, de guerres homériques et d’exterminations pointilleuses. Toute l’Histoire humaine n’est que le récit sanglant de notre inventivité à créer de nouvelles armes sophistiquées, de nouvelles méthodes de destruction massive. Il n’y a pas d’Histoire sans cadavres. L’Histoire est une enquête quasi criminelle, une façon de rassurer les vivants du sacrifice des vaincus. D’une manière ou d’une autre, nous sommes les descendants de ceux qui commirent d’abominables massacres ou qui y survécurent. C’est bien cela qui étonne, cette capacité qu’ont les hommes à s’infliger les pires souffrances et, au bout du compte, à les surmonter.
La violence est pourtant bien plus que l’expression d’un rapport de force, d’une puissance physique. Elle exprime aussi, depuis toujours, la complexité de la relation que nous entretenons avec le réel et ses représentations symboliques.
Qu’un conseil d’administration décide d’un licenciement massif ou d’une délocalisation, et voilà que la vie de ceux qui s’étaient dévoués corps et âme à leur entreprise se retrouve broyée, pour de vagues considérations financières. Le bien être des serviteurs importent peu aux maîtres. Ces mêmes conseils d’administration votent pour que l’expropriation des faibles accroissent le rendement de leurs fortunes. Et bien, si des pipe-lines saccagent des terres sacrées, derniers sanctuaires de peuples autochtones, que peut-on y faire ? Le monde civilisé n’a triomphé qu’en faisant preuve de cynisme, pour toujours mieux satisfaire sa convoitise. Il n’y a pas d’alternative, proclame-t-il, à la marche du progrès. Toutes les raisons sont bonnes pour justifier l’oppression ; le droit est presque toujours l’allié du plus fort.
La puissance politique possède aussi ses propres motivations qui, souvent, défient les lois de l’entendement. L’implosion de la Syrie illustre malheureusement à quelles vilénies un dictateur est prêt à s’abaisser pour conserver un pouvoir de pacotille. Ne sait-il pas qu’un peuple fantôme agonise dans son royaume des ombres ?
Sur les champs de bataille, les hommes s’entretuent pour des raisons dont les véritables enjeux leur échappent complément, mais ils s’étrillent et agonisent, fiers comme des soldats, en respectant un code de l’honneur et une hiérarchie qui leur impose l’ultime sacrifice. La vraie puissance n’est donc pas au bout du fusil, mais dans l’obscur cerveau d’un chef de brigade, d’un général ou d’un empereur qui commande à ses troupes de tuer ou de mourir pour satisfaire ses ambitions personnelles, comme si sa vie avait plus de valeur que celle de ses hommes.
La violence à son paroxysme se confond avec la folie, sans doute, parce qu’elle émane d’une pulsion inconsciente, où la destruction de l’autre et de soi-même s’entremêlent. En éliminant l’autre, je me tue moi-même. L’autre est celui qui me reconnait en tant qu’entité distincte. Si l’autre n’existe plus, qui me dira qui je suis ? Les terroristes ont perdu depuis longtemps toute notion d’identité personnelle. Ils n’appartiennent plus au genre humain, mais à sa négation. C’est pour cela que la violence de leurs crimes nous effrayent tant.
Une société où règne l’ordre sans la justice est propice à la tyrannie, tandis qu’une société où la justice triomphe sans ordre favorise son déclin. Aujourd’hui, qu’un imbécile à demi-élu mette en péril l’idée même de démocratie, montre bien que notre civilisation a manqué de lucidité et de modestie sur le bien fondé de sa toute puissance et de son efficacité.
De la même façon qu'il n’y a pas d’Histoire sans cadavre, il n’y a pas de Civilisation sans violence… Et pourtant, notre héritage préhistorique ne se réduit pas à ce qu’il a y de plus obscur en nous. L’humanité a démontré ses dons exceptionnels pour la réalisation d’un véritable progrès humain, faisant place à la créativité, mais aussi à la solidarité et à la compassion… Nous sommes capables du meilleur, mais nous nous contentons du pire ! Y a-t-il une fatalité à cela ? Pouvons-nous encore changer notre nature humaine pour la rendre plus harmonieuse et plus respectueuse de la Vie ?
Nous ne pouvons devenir humain, qu’en acceptant de vaincre la peur et en nous ouvrant à l’amour.